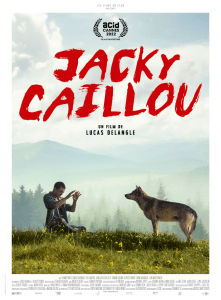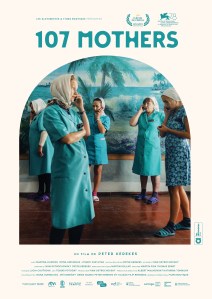75e Festival de Cannes
Compétition Officielle
Sortie le 9 novembre 2022
Par un imposant plan-séquence sur le port automne de Papeete avalé par la nuit, l’île de Tahiti se révèle par la fatalité économique de son rapport avec l’ailleurs. Les premiers personnages de Pacifiction – Tourment sur les îles, des marins de l’armée française sur un bateau pneumatique, rejouent un mirage funeste de la colonisation. Les relations entre Tahiti et l’extérieur prennent forme sous les traits du Haut-commissaire de la République De Roller (Benoît Magimel, époustouflant). Dans la lignée des protagonistes de ses précédentes œuvres, De Roller s’inscrit comme une figure romanesque à l’instar de Don Quichote (Honor de cavallería, 2006) ou de Louis XIV (La Mort de Louis XIV, 2016). Mercenaire volubile, il traverse les plans – et s’en empare – dissimulé sous son armure néocoloniale : un costume d’un blanc immaculé et des lunettes aux verres teintés. Chez Albert Serra, le politique est une mise en scène qui s’exprime par le biais du corps. Après la débauche charnelle de Liberté (2019) que l’entre-soi érotique de la boîte de nuit « Paradise Night » ravive, Pacification – Tourment sur les îles prône une débauche verbale qui se vautre dans une vacuité formalisée. L’étirement des séquences transforme les échanges entre De Roller et les concitoyen·ne·s en des monologues absurdes louant le néant des manœuvres du pouvoir. Albert Serra évoque l’artificialité de nos représentants annonçant que « la politique [est] comme une discothèque : une soirée avec le diable ».
Tandis que les rumeurs s’intensifient sur l’île, le Haut-commissaire enquête sur la menace invisible d’une reprise des essais nucléaires qui ont contaminé la région entre 1966 et 1996. Au crépuscule, il scrute depuis les hauteurs d’une colline l’immensité de l’océan en quête des traces d’un sous-marin français. Albert Serra altère le réel faisant apparaître ledit navire tel un monstre marin mythologique, imposant un doute permanant à ses protagonistes tombant dans une sombre paranoïa à la manière de l’amiral (Marc Susini) dont l’alcool démultiplie les « ennemis ». Pacification – Tourment sur les îles est un thriller politique dont l’intrigue n’est qu’un prétexte pour épaissir le brouillard se levant sur un monde contemporain nébuleux. De Roller s’acharne sur des pistes concrètes, la fréquentation régulière du « Paradise Night » par l’équipage de l’amiral ou la présence énigmatique d’étrangers – un Portugais (Alexandre Melo) dont le passeport diplomatique aurait été dérobé et un Américain (Mike Landscape) guettant les moindres faits et gestes du Haut-commissaire. Alors qu’il l’observe, l’Américain indique que De Roller « tourne en rond », empêtré dans une « spirale descendante ». En effet, ce dernier déambule dans sa Mercedes blanche dans les mêmes lieux de l’île à la recherche d’une lumière pour éclairer ce territoire tourmenté, pareillement à la lumière artificielle d’un stade lors d’une averse qui semble le recharger.
Porté par le jeu magnétique de Benoît Magimel, De Roller est un personnage ambivalent à la magnanimité hypothétique. S’il prône la nécessité de « se désincarner » pour être un bon politicien, il n’est qu’un pion étatique pour maintenir l’ordre (l’intérêt de la France) qui ne prend en compte l’intérêt commun des Tahitien·ne·s que lorsqu’il rencontre ses propres névroses paranoïaques. Le Haut-commissaire se laisse progressivement dévorer par le territoire tahitien d’apparence paradisiaque. Lors de la séquence magistrale de la compétition de surf, son embarcation se heurte aux vagues immenses le faisant disparaître du plan. Alors qu’un surfeur déclare que « tous les jours [son] lieu de travail essaie de le tuer », ces paroles résonnent avec la situation de De Roller, ballotté. À la manière de cette séquence qui aurait pu n’être qu’une façade touristique, le cinéma d’Albert Serra va à l’encontre de toute exotisation. Il dépeint une société tahitienne dont la révolte de la jeunesse gronde en filigrane. Pacifiction – Tourment sur les îles se fait le miroir critique, transcendé par les néons du « Paradise Night », d’un exotisme difforme où le·a Tahitien·ne n’est vu·e – par les personnages blancs – qu’à travers leurs propres fantasmes : des serveur·se·s dénudé·e·s aux danseur·euse·s, seul·e·s autorisé·e·s à témoigner d’une violence politique encadrée par les limites rassurantes d’un spectacle pour touristes.
Avec son rythme obsédant, Pacifiction – Tourment des îles est un cauchemar politique déguisé en rêve touristique. L’œuvre est autant une réflexion sur la vacuité rhétorique d’une classe politique blanche paranoïaque que sur le péril d’une masculinité primaire libidineuse. Face à eux, Albert Serra exalte des personnages autochtones déterminés à reprendre en main leur destin et celui de l’île à l’instar de l’hôtesse Shannah (Pahoa Mahagafanau, envoûtante), muse de De Roller.
Le Cinéma du Spectateur
☆☆☆☆☆ – Chef d’Oeuvre