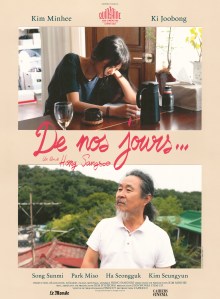76e Festival de Cannes
ACID
Sortie le 8 novembre 2023
Au cœur de la guerre, un van sillonne les routes endommagées de l’Ukraine. Conduit par un Polonais polyglotte, son objectif est d’évacuer des civil·es à l’extérieur du pays. Durant ces fuites organisées, la menace de l’invasion russe est permanente, comme accrochée au pare-chocs arrière de la voiture. Depuis le cockpit, la guerre est omniprésente. Le véhicule s’avance dans un paysage apocalyptique dont les destructions alentours (immeubles éventrés, ponts détruits, voitures calcinées) témoignent de la violence des assauts passés de l’armée russe. Parmi les ruines, des explosions retentissent, indiquant autant la proximité des conflits que l’interception de missiles par l’armada antiaérienne. Les enfilades de chars d’assaut allant dans le sens inverse du van rappellent que le conflit est encore en cours. Imprévisible, la guerre force chacun·e à se tenir constamment informé·e. Le conducteur est inséparable de son téléphone qui lui indique en temps réels les modifications de la ligne de front. Détruits ou minés, les chemins se rallongent inlassablement.
Dans l’habitacle, les esprits sont perdus dans un même labyrinthe, émotionnel. Les passagèr·es sont suspendu·es dans une temporalité entre le danger et la sécurité, dans un territoire inconnu où les corps peuvent enfin se relâcher. Refuge fragile, la voiture apporte un répit douloureux. Si certain·es dorment, d’autres commencent de difficiles deuils : une fille pleure sa mère dont le corps est introuvable ; une femme pleure son mari mort au front. Pierre Feuille Pistolet unit les destins de ses protagonistes de passage dans une même douleur. Par la présence de la caméra, Maciek Hamela donne à ses témoins, habituellement réduit·es à l’anonymat, l’opportunité de raconter leurs histoires. Libérée de la peur, cette précieuse parole permet de ressusciter, par le prisme du souvenir, l’âme de la société ukrainienne. Récit choral de la douleur d’un peuple, l’œuvre comble les interstices des destinées piétinées par la Russie. Alors que le paysage défile, iels verbalisent les traumatismes qui les suivront pour le restant de leurs jours – à l’instar de Sofia, 5 ans, qui a développé une peur panique des avions.
Mais, Pierre Feuille Pistolet n’est pas que le récit misérabiliste de l’horreur qui se joue hors-champ. Le trajet est aussi un entre-deux entre la vie perdue et celle à reconstruire. Être présent·e dans cette voiture est déjà une victoire en soi. Malheureusement, certaines histoires s’arrêtent brutalement en amont comme ce jeune garçon embrigadé de force dans l’armée russe à un contrôle. Fonçant vers la liberté, les conversations permettent de redonner un sens au réel. Sur les ruines qui les entourent, les protagonistes se réapproprient le territoire à la manière de cette fillette qui, voyant la mer, songe déjà à revenir s’y baigner l’été prochain. Iels reprennent le contrôle de leur destinée partageant leurs projets. Après quelques grossesses pour autrui, une des passagèr·es dit qu’elle pourra réaliser son rêve d’enfant : un café avec des pâtisseries. La possibilité de rêver conduit aussi une aristocrate à s’imaginer en « grenouille voyageuse », parcourant l’Europe qu’elle désirait tant découvrir. En pointant sa caméra vers le siège arrière, Maciek Hamela redonne une humanité, et donc un espoir. Il crée un espace propice aux miracles, à l’instar de cette petite fille mutique depuis une explosion qui retrouve la parole.
CONTRECHAMP
☆☆☆☆ – Excellent