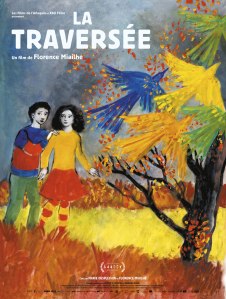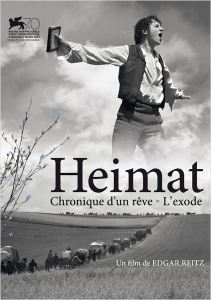73e Berlinale
Perspektive – Prix Compass & Prix pour la paix
En salles le 29 mars 2023
2007, Téhéran. Le nom et le visage, reconnaissable malgré une tentative d’anonymité, de Reyhaneh Jabbari apparaît à la une des journaux iraniens. La téhéranaise de 19 ans est accusée d’avoir tué, avec préméditation, le notable iranien Morteza Abdolali Sarbandi. En réalité, l’ancien agent des services secrets avait abordé la jeune décoratrice dans un café, après l’avoir entendue au téléphone, prétextant avoir besoin d’aide pour rénover son cabinet de chirurgie esthétique. Une fois le piège tendu, il avait tenté de la violer dans son appartement – avec l’aide d’un complice bloquant la porte – et elle avait pu repousser son assaillant par le biais d’un couteau laissé sur la table. À la suite d’une enquête truquée et d’un procès illusoire qui refuse de reconnaître le cas de légitime défense, Reyhaneh est condamnée à la peine de mort. Suivant les lois de Qisas [du talion], la famille de la victime peut accorder son pardon à la jeune femme murant les Jabbari dans une attente de sept ans jusqu’au 25 octobre 2014, jour où Reyhaneh est pendue à la prison de Gohardasht.
Sept hivers à Téhéran se confronte alors au réel – celui dicté par le régime iranien – en examinant une histoire dont les traces ont été soit falsifiées soit détruites. Comment représenter ce qui ne doit pas exister ? La cinéaste allemande Steffi Niederzoll ouvre son premier long-métrage documentaire par une réponse : une maquette. Référence au travail de décoratrice à mi-temps de Reyhaneh, elle réorchestre l’espace offrant, dans ces abris en carton, une scène pour accueillir le témoignage de sa protagoniste. À travers des enregistrements audio (ou des lettres récitées par l’actrice et réalisatrice iranienne Zar Amir Ebrahimi) collectés durant sa période d’emprisonnement, la voix de Reyhaneh retrouve un auditoire qui dépasse les murs de ses prisons successives. Par des archives familiales en VHS et des cassettes mini DV, elle reprend corps affichant une vitalité ensuite volée par le régime iranien. Alors qu’un texte introductif rappelle qu’enregistrer illégalement des images et des sons en Iran est passable de cinq années d’emprisonnement, Sept hivers à Téhéran devient le plaidoyer autant d’une liberté d’expression que d’archivage des luttes populaires et contestataires. Dans les soubresauts d’un plan hésitant ou les pixels d’un téléphone portable vibre le courage politique des « anonymes » (par nécessité), notamment la famille Jabbari et leurs proches, qui se battent pour mettre en lumière la réalité du peuple iranien.
Face au système patriarcal iranien, Reyhaneh s’insurge de l’inévitable culpabilité, légale et/ou sociale, d’une femme dans un contexte de viol : « Si tu résistes, tu es condamnée / Si tu te défends, tu es condamnée / Si tu te laisses faire, tu es condamnée ». Dans un aveu glaçant filmé en Allemagne par Steffi Niederzoll, Sharare Jabbari (l’une des deux sœurs cadettes de Reyhaneh) loue d’ailleurs le courage, qu’elle n’aurait pas eu à l’époque, de son aînée d’avoir la force de s’être défendue à seulement 19 ans, tout en confessant – qu’au regard du traitement de la légitime défense pour une femme fans la loi iranienne – qu’elle se laisserait également faire si cela se produisait maintenant. Pendant les sept hivers qu’elle passe en prison, Reyhaneh quitte son habitus, forgé dans une classe moyenne et artistique, et découvre la réalité des femmes des milieux pauvres et populaires. Parmi les prostituées et les droguées, elle déconstruit son regard biaisé, prend conscience de la caractéristique systémique de l’oppression masculine et intercède pour sauver ses sœurs. Sept hivers à Téhéran témoigne alors de la funeste beauté d’une trajectoire politique construite par et avec les opprimées. Un combat primordial qui continue de vivre à travers multiples femmes sauvées de la peine de mort par Shole Pakravan, mère de Reyhaneh, dont l’âme lumineuse parcourt ce documentaire édifiant.
CONTRECHAMP
☆☆☆– Bien