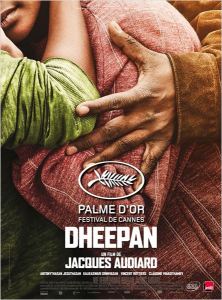77e Festival de Cannes
Grand Prix
Sortie le 2 octobre 2024
Dans les rues animées de Mumbai, la caméra de Payal Kapadia flâne au rythme d’une foule ordinaire. Alors que certains visages émergent, un chœur citoyen conte en voix-off les souffrances urbaines transformant les rêves en illusions. Paradoxalement, la cinéaste indienne appréhende le collectif via sa capacité à se fragmenter, puisant dans l’unicité de chacun·e une force romanesque commune. Multipliant les points de vue d’une domination partagée, son cinéma forge les contours des révoltes populaires – celle des étudiant·es indien·nes de Toute une nuit sans savoir [Inde, 2021] – ou silencieuses – celle vécues par Anu, Prabah et Parvaty dans All We Imagine as Light. À travers le destin de ces trois infirmières d’âges différents, Payal Kapadia adresse la place des femmes au sein de la société indienne. Elles sont hantées par les spectres d’un patriarcat omniprésent : Anu (Divya Prabah) fuit les profils inanimés de prétendants envoyés par sa mère ; Prabah (Kani Kusruti) est sans nouvelles de son mari parti en Allemagne depuis des années ; et Parvaty (Chhaya Kadam) cherche dans les affaires de son défunt mari les preuves administratives qui lui éviteraient l’éviction.
Dans cette société moraliste où chacun·e joue un rôle coercitif, l’amour doit être une affaire privée – comme le rappelle le docteur épris de Prabah lorsqu’il lui demande d’attendre d’être chez elle pour lire son poème ou manger les friandises qu’il lui a offertes. Aux détours des rues principales, la tentaculaire Mumbai octroie tout de même des espaces dissimulés, comme l’arrière d’un terrain de football, pour d’accueillir les désirs des amant·es perdu·es. Pourtant, les hésitations d’Anu et de son amant clandestin, Shiaz (Hridhu Haroon), prennent la forme d’une pluie interrompant inlassablement la possibilité d’un futur ensemble. Au-delà de simples récits d’émancipation, All We Imagine as Light appréhende les complexités morales de ses personnages, travaillant la matière de cette pesanteur qui fait que le présent empêche l’arrivée du futur. Kapadia célèbre les moments, même fugaces, où l’individu s’aligne à ses désirs et à ses peines. Même si timidement, Prabah et Parvaty expriment, par le jet d’une pierre pourfendant la nuit, leur colère contre l’expropriation de cette dernière. Par la tendresse de sa mise en scène, l’amour d’Anu et de Shiaz transcende les rumeurs qui les accablent par une simple main saisie discrètement alors qu’iels attendent pour traverser la rue.
À la manière d’Anu utilisant son stéthoscope sur des objets inanimés puis sur elle, Kapadia cherche en permanence un pouls, une énergie qui emporterait tout sur son passage. Les sentiments, comme les orages qui balayent la ville, grondent en permanence. Ils chargent d’une force dramatique rare des gestes pourtant anodins – l’étreinte d’un cuiseur à riz venu d’Allemagne en pleine nuit ou encore le retrait d’un voile dans le métro. Alors que les trois femmes quittent quelques jours Mumbai pour un paisible village côtier, la lumière gagne en intensité. Loin du tumulte de la ville, elles s’offrent la possibilité d’une guérison. À l’instar de cette grotte réunissant les amant·es d’hier et d’aujourd’hui, All We Imagine as Light naviguent alors entre la réalité et l’imaginaire. Sur la plage, Kapadia construit un refuge, une parenthèse nécessaire, dans lequel la violence du monde ne peut plus les atteindre. Grâce à cette sororité (re)trouvée, chacune peut enfin entrapercevoir les lueurs d’un futur.
CONTRECHAMP
☆☆☆☆☆ – Chef d’Oeuvre