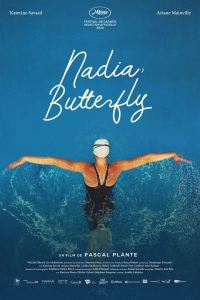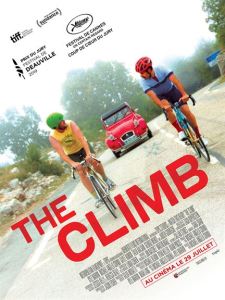73e Festival de Cannes
Sélection Officielle
Sortie nationale le 11 août 2021
Dans le deuxième long-métrage de Farid Bentoumi, la couleur rouge occupe une place essentielle et se transforme au gré d’une polysémie figurative. Le Rouge, éponyme, est d’emblée cette usine rouge se dressant tel un rempart social dans les paysages verts de l’Isère. Fièrement, l’édifice trône au cœur de la vallée, de la ville et de la vie de ses ouvrier.e.s. « C’est chez moi ici » rugira d’ailleurs Slimane (Sami Bouajila) au visage de son patron. Délégué syndical et pilier de l’entreprise Arkalu, il représente cette génération ouvrière rompue au paternalisme salarial qui défend conjointement, dans une logique commune de survie, l’emploi et l’essor économique. Avec sa structure de fer rouge, l’usine s’appréhende comme un moteur sociétal sauvant les alentours d’une précarité croissante – à l’instar de la jeune Nour (Zita Hanrot), fille de Slimane, qui est engagée comme infirmière après un accident aux urgences de l’hôpital où elle travaillait précédemment. L’hégémonie d’Arkalu résonne jusque dans les décisions politiques de la région, puisque seul le vote des ouvrier.e.s est synonyme de victoire. Face à la montée du Rassemblement Nationale, les Écologistes sont obligé.e.s de répondre dans leur programme, devenant alors schizophrénique, aux intérêts des filles et fils d’Arkalu.
Ensuite, le rouge est évidemment cette boue rougeâtre qui se déverse illégalement dans le territoire isérois et qui ronge les écosystèmes environnants. Auparavant déversés en pleine nature (au « lac »), les déchets toxiques d’Arkalu ont empoisonné la terre forçant, par la complicité d’un arrêté municipale, à l’abandon des habitations les plus proches et contraignant leurs occupant.e.s exposé.e.s à subir les mêmes séquelles médicales que les ouvrier.e.s de l’industrie lourde. À l’abri des regards (et donc des contrôles), la boue est maintenant enterrée dans des carrières abandonnées et continuent d’avoir des impacts désastreux sur l’environnement. Par ce glissement figuratif du rouge, l’œuvre de Farid Bentoumi se mue en un thriller politique et écologique déconstruisant intelligemment les idéaux de ses différents personnages. À l’image, les méfaits d’Arkalu sont cette poussière rouge volatile dans laquelle travaillent inlassablement les ouvrier.e.s sans protection. Elles recouvrent les corps fatigués et abîmés de cette classe ouvrière déterminée jusqu’à se retrouver sur la traîne d’une robe de mariée. Cette boue rouge, remplissant les dangereux tuyaux de l’usine, se teinte aussi du sang des ouvrier.e.s contraints, face aux journalistes et aux associations, de ne former qu’un unique corps avec l’usine.
Enfin, le rouge symbolise le feu qui bouillonne progressivement dans les yeux de Nour. À travers elle, Rouge retrace le parcours d’une radicalisation écologique. « Est-ce qu’il y a une solution politique ? Non » questionne de manière rhétorique J.B. (Abraham Belaga), l’activiste environnemental qu’a fréquenté la journaliste Emma (Céline Sallette). Face à ce constat, Nour se confronte ou s’allie à une succession de personnages accrochés à leur position individualiste : un patron avide (Olivier Gourmet), un délégué du personnel aveuglé ou une journaliste obstinée. Le scénario est habilement écrit, car il prend le temps de disséquer les rapports de force internes à chaque personnage. Farid Bentoumi s’applique en les confrontant à chercher l’équilibre entre la morale et la nécessité. Sans jugement, Rouge présente des hommes et des femmes acculé.e.s face à des enjeux qui les dépassent et dont ils sont les pions. Face aux débats improductifs et biaisés par le manque de transparence de l’usine, la lutte s’intensifie via des actions d’éco-terrorisme. Le feu, littéralement allumé, nourrit les engagements militants prônant une société où la santé des individus prévaut sur l’accroissement du capital.
Rouge est influencé par les thrillers politiques américains dont il reprend à la fois l’efficacité (du scénario) et l’aseptisation (d’une vie autre cantonnée à ne répondre qu’aux exigences de ce scénario). Sans misérabilisme ni pathos, le long-métrage se veut être un électrochoc pour son spectateur qu’il guide vers une nécessaire lutte citoyenne pour l’environnement !
Le Cinéma du Spectateur
☆☆ – Moyen