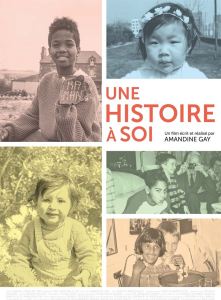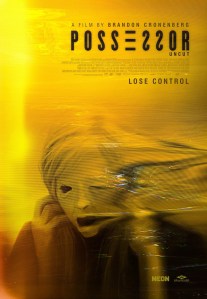76e Mostra de Venise
Sélection Orizzonti
Sortie nationale le 28 juillet 2021
Dans les ruelles poussiéreuses de Téhéran, une opération policière de grande ampleur tente de débusquer des trafiquants de drogue. Lors de cette séquence d’ouverture haletante, l’ensemble du discours de La Loi de Téhéran se dessine symboliquement. Il y a d’abord cet enchevêtrement de nombreuses portes à défoncer qui présage d’une enquête épineuse où chaque piste conduira à un nouveau mur ne pouvant être détruit que par l’usage de la force, physique ou psychologique. Ensuite, le suspect n’est littéralement qu’une ombre qui plane au-dessus des policiers : un corps sans visage qui se délite dans le tracé alambiqué de la capitale iranienne. Dans un régime politique et judiciaire poreux, cette identité trouble devient le terrain d’un jeu d’échecs servant le dessin à la fois des malfaiteurs intégrés au système et des policiers s’amusant de la morale. Enfin, la finalité funeste de cette course-poursuite acharnée dans Téhéran infuse le réel d’une implacable fatalité orchestrée afin de broyer la destinée des différents personnages.
Reposant sur les codes universels du thriller, le long-métrage de Saeed Roustayi est le récit d’une enquête, plutôt limpide, allant des accros au crack stagnant dans les bidonvilles de Téhéran aux grands pontes d’un trafic pensé à l’échelle mondiale. À travers une suite d’interrogatoires et de mandats de perquisition, La Loi de Téhéran esquisse une cartographie verticale de la ville allant des quartiers les plus pauvres au sommet des gratte-ciels luxueux surplombant fastueusement la pauvreté environnante. Au fur et à mesure, l’œuvre se transforme en une critique sociale autour de l’arrestation de ce baron de la drogue (Navid Mohammadzadeh) ayant réussi à sortir de la misère. Porté par un scénario essentialiste, il devient le porte-parole des plus démuni.e.s face à des institutions moralisatrices ne pouvant que constater leur propre échec. « Vivre dans les quartiers pauvres demande de la force, ma famille n’en a pas », proclame-t-il dans un élan de justification. De là, la dogue se révèle être la seule arme possible au sein de la lutte des classes pour sortir de sa propre condition et combler la distance toujours croissante entre les Riches et les Pauvres.
À la suite de l’enquête policière, cette dimension sociale – flirtant avec le pathos – se double d’une critique du système pénitencier et judiciaire iranien. La Loi de Téhéran se présente comme un précis de corruption (ou du moins de possibilités de corruption). La mise en scène de Saeed Roustayi construit un miroir entre les échanges de bons procédés des prisonniers agglutinés de manière inhumaine dans des cellules volontairement remplies jusqu’à leur point de rupture et ceux des policiers agissant dans l’enfilade des bureaux. Au cœur de ce lieu lugubre, s’organise un théâtre des plaintes et des délits où la vérité mute au contact des mensonges et/ou des falsifications. Pessimiste, La Loi de Téhéran dénonce l’impossibilité de ce simulacre morale à endiguer le fléau de la drogue notamment exacerbé par la décision de punir de la peine de mort la possession de drogue en Iran, quelle que soit la quantité. Alors que l’un des cerveaux du trafic est condamné à mort, une nouvelle opération de police déloge une horde de drogué.e.s (zombifié.e.s) d’un terre-plein central d’une autoroute menant à Téhéran dont les tours émergent à l’horizon.
La Loi de Téhéran est indéniablement un thriller implacable. Néanmoins, comme la bureaucratie dont Saeed Roustayi fait la critique, il ne cherche qu’à remplir un cahier des charges performatif. Programmatique, l’œuvre ne parvient pas à faire émerger une émotion autrement qu’artificielle chez ses personnages. Du cinéma social, le cinéaste iranien ne garde qu’une distance affective.
Le Cinéma du Spectateur
☆☆ – Moyen