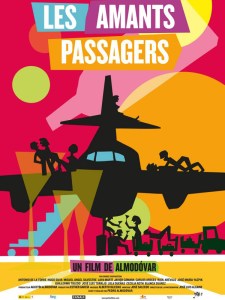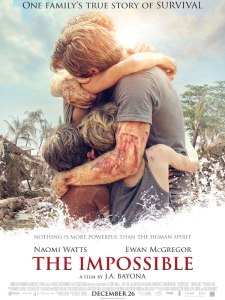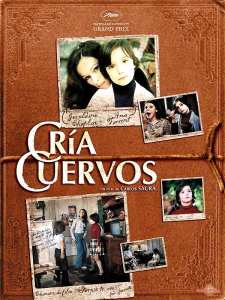36e édition des Premios Goya
Meilleur Documentaire
Sortie le 20 avril 2022
En 2016, Jonás Trueba filmait des jeunes adolescent.e.s madrilènes pour son long-métrage de fiction La reconquista. Pressentant qu’une autre histoire était à raconter cette fois-ci dans le temps présent du documentaire, le cinéaste les a suivi.e.s pendant 5 ans afin de réaliser le portrait choral de la jeunesse espagnole contemporaine. Qui à part nous est une œuvre collective qui s’érige doublement autour de la notion centrale du « nous ». D’une part, Jonás Trueba s’intéresse aux forces coercitives qui constituent un groupe, instituant une frontière générationnelle et affective entre le « nous » et le reste de la société. D’autre part, il s’agit de soulever un enjeu cinématographique et politique du cinéma, principalement documentaire, en cherchant à créer un lien direct entre le sujet et la narration. Comme annoncé en préambule de l’œuvre, Qui à part nous se vit de manière « immersive » dans un dispositif où le.a spectateur.rice ne sera que le réceptacle d’une génération qui se livre, se regarde et s’invente uniquement par et pour elle-même. Dès la séquence d’ouverture, Jonás Trueba détruit la notion de quatrième mur en enregistrant la conversation virtuelle, pandémie oblige, réunissant les acteur.rice.s/sujets qui découvrent collectivement le film pour la première fois. En conclusion de son œuvre, le cinéaste espagnol reproduit le même procédé d’identification au groupe, au nous, en captant les réactions de lycéen.ne.s ému.e.s devant Qui à part nous. Jonás Trueba consacre alors sa position d’observateur d’une jeunesse pleinement acteur de sa représentation et consciente de son héritage.
À la manière de Sébastien Lifshitz (Adolescentes [2020]), l’ambition première de Qui à part nous est de redonner une voix empathique à l’adolescence au cinéma. En se mettant à leur hauteur, Jonás Trueba questionne les jeunes sur la manière dont iels se sentent représenté.e.s au cinéma. Alors qu’iels affirment que leurs vies sont dramatisées à outrance – notamment par le prisme de l’addiction à la drogue, l’une des adolescent.e.s avoue qu’elle souhaiterait qu’iels soient représenté.e.s « comme des personnes ». La simplicité de la réponse témoigne avec force de la distance qui s’est instaurée entre la jeunesse et celleux qui les regardent. Alors qu’iels explorent les moyens formels de contrecarrer cette distance, une solution émerge : l’apparition d’une voix-off pour être au plus près de la psyché des personnages adolescents. Car, cette psyché n’est que rarement envisagée dans les représentations adolescentes comme une individualité singulière et surtout dans son propre rapport à la solitude – considérée autrement que comme le résultat d’un harcèlement scolaire. Avec poésie, Ricardo confessera que « dès qu’[il] rentre dans [sa] chambre, c’est incroyable tout ce qui se passe dans [sa] tête », ouvrant un nouveau champ des possibles. Qui à part nous embrasse alors le parti-pris de la voix-off en lui donnant une ampleur collective. Les images hybrides, oscillant entre le documentaire et la fiction, sont ainsi explicitées et contextualisées par une voix-off collégiale formant un chœur à la manière du théâtre grecque antique scellant le destin commun du groupe. La fiction chez Trueba s’insère comme révélateur du réel, comme la mise en situation sociologique et émotionnelle transformant le témoignage en récit.
Qui à part nous esquisse le portrait d’années formatrices où le microcosme adolescent entre en friction avec un macrocosme inhospitalier où la place occupée par l’individu est une lutte perpétuelle. Jonás Trueba témoigne de l’effervescence des questionnements qui bouillonnent dans les cerveaux adolescents composant progressivement une conscience politique. Avec perspicacité, iels cherchent à définir qui iels sont et surtout qui iels deviendront. Des jeunes radicaux et anarchistes qui proclament qu’une révolution est nécessaire, que restera-t-il alors qu’iels sont elleux-mêmes témoin de la droitisation de leurs parents ? La longue durée de l’observation (5 ans) permet justement de voir comme les pensées révolutionnaires, voire utopiques, se confrontent à l’implacabilité d’un réel élaboré pour museler ces voix alternatives. Dans une conversation passionnante sur la manière dont la lutte doit/peut prendre forme face à cette désillusion politique naissante, la légitimation de la violence comme seul moyen d’action est proposée. Face au désaccord, le groupe s’unit à nouveau autour d’un cri commun : qui à part nous doit tenir ce rôle de contre-pouvoir ? Qui à part nous prône dans son discours, comme dans la forme que prend la singulière filmographie de Jonás Trueba, une action politique du quotidien qui passe par la beauté des micro-actions. La force de l’œuvre est justement de mettre en lumière des révolutionnaires du quotidien, d’un quotidien qu’iels font leur. Cette vitalité est malheureusement balayée par la pandémie de la COVID-19 rétractant encore plus l’horizon d’une génération hantée autant par la peur de la mort que par la peur de la vie.
Le Cinéma du Spectateur
☆☆☆☆– Excellent