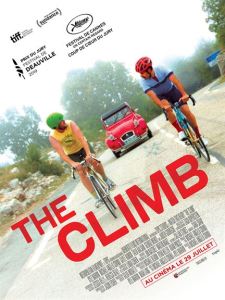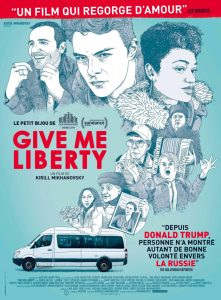10. High Life, Claire Denis
(France)
Dans le cinéma de science-fiction, High Life s’affilie à un grandiose minimalisme, de Solaris (Tarkovski, 1972) à Under the Skin (Glazer, 2014), qui permet, par la pure mise en scène, une ouverture transcendantale. Prêchant l’abstraction, Claire Denis se libère d’un carcan scénaristique traditionnel pour atteindre l’hypnose. Prônant l’extase sensorielle, la cinéaste française juxtapose la fascination et la répulsion, le lyrisme et le prosaïsme, le vide et le trop-plein. Sous les enjeux de filiation de ces détenus utilisés pour des expériences de procréation en milieu spatial, High Life dresse le portrait d’une humanité sans idéal ni espérance errant dans l’espace comme dans le temps. Chérissant le détour, elle brouille la temporalité de son récit pour suivre le fil d’Ariane d’une folie latente sans cesse repoussée par un père flegmatique, Robert Pattinson, résigné à survivre sans certitude ni désir.

9. Mektoub, My Love : Canto Uno, Abdellatif Kechiche
(France)
Mektoub, My Love : Canto Uno est la quintessence du cinéma d’Abdellatif Kechiche : une malicieuse candeur sculptée par le cadre d’une caméra qui absorbe en permanence les corps et les émotions pour les transcender et les ennoblir. Dans ce sixième long-métrage, il se libère d’une négativité mécanique qui déterminait ses personnages à l'(auto)destruction. Sur les plages de Sète, l’art de Kechiche devient vitaliste au contact de ces adolescents, à l’hédonisme et à la sexualité assumés. Le cinéaste appréhende, avec une rare justesse, cet âge comme une perpétuelle confusion entre vacuité et sublime. Il saisit l’ivresse d’une jeunesse en quête d’un mouvement qu’il accompagne, sans cesse, jusqu’à l’enivrement à la manière de cette scène étourdissante de volupté et d’excitation dans une boîte de nuit. Ode à la sensualité, Mektoub, My Love : Canto Uno est un conte d’été sans morale puisque marchant impétueusement vers l’émancipation et la liberté.

8. Avant que nous disparaissions, Kiyoshi Kurosawa
(Japon)
Dans la filmographie inégale de Kiyoshi Kurosawa, le sublime émerge invariablement dans le glissement du réel dans une altération fantastique. Par ses lentes imbrications métaphysiques, le cinéaste japonais abolit les frontières avec l’au-delà, qu’il s’agisse de la mort (Vers l’autre rive, 2015) ou de l’espace (Invasion, 2018). Jouant avec les codes de la science-fiction, Avant que nous disparaissions trouve dans la subtilité de son dispositif – des extra-terrestres prenant la possession d’êtres humains pour voler les concepts créés par l’humanité avant d’annihiler la planète entière – une subtile force qui annonce la fin de la civilisation avec une mélancolique terreur plus évidente et émouvante que les efforts pyrotechniques d’Hollywood. Kiyoshi Kurosawa, par la persistante obsession de l’amour, signe une fable philosophique, ubuesque et terrifiante, sur le chaos de la société et les peurs collectives qui le nourrissent.

7. Un Couteau dans le cœur, Yann Gonzalez
(France)
Un couteau dans le cœur est une ode graphique au Giallo, ces thrillers italiens des années 1970. À la frontière entre cinéma policier, horrifique et érotique, l’œuvre utilise, à la manière du maître Dario Argento, le fil conducteur d’une enquête comme prétexte à des expérimentations tendant vers une abstraction orgiaque. Yann Gonzalez confirme, après Les Rencontres d’après-minuit (2013), un goût pour la référence, certes, mais toujours subtilement altérée, comme pour prendre à rebours son propre cadre de représentation. S’ouvrant sur le meurtre, graphiquement morbide, d’un acteur porno gay, Un couteau dans le cœur se place directement dans la marge : une marge formelle que son cinéaste dissèque et triture (comme sur une table de montage) ; et une marge scénaristique, l’univers de la pornographie homosexuelle, qu’il hante d’une pulsion de vie et d’une envie de mort. Peu de cinéastes ont encore cette confiance, presque prosaïque, dans la force de monstration de l’image – une singularité héritée justement du cinéma pornographique qui permet cette jouissance proprement cinématographique.

6. Diamantino, Gabriel Abrantes & Daniel Schmidt
(Portugal)
Les expérimentations formelles de Diamantino résonnent parmi l’avant-garde portugaise qui prêche l’immersion du poétique dans le quotidien morose du Portugal. Après l’érotique João Pedro Rodrigues (O fantasma, L’Ornithologue), le mythologique Miguel Gomes (Tabou, Les Mille et une nuits) et le romantique João Nicolau (John From), le cinéma lusophone se pare des joyaux pop du duo Abrantes-Schmidt. Entre kitsch et science-fiction, Diamantino offre un manifeste baroque au brûlot politique du Portugal. Parabole drolatique, l’œuvre choisit l’exubérance, aussi bien scénaristique que visuelle, comme arme de destruction massive des maux intrinsèques de la nation portugaise. Une vision enchanteresse dans laquelle la béatitude se quantifie au nombre de chiens géants gambadant dans un stade de football, cathédrale moderne des espérances d’une nation ! (Critique)

5. Under the Silver Lake, David Robert Mitchell
(États-Unis)
Œuvre hallucinante et hallucinatoire, Under the Silver Lake est une double relecture cinématographique des polars californiens. D’une part, David Robert Mitchell modernise et déconstruit les codes du film noir par le biais d’une esthétique post-MTV. Le cinéaste navigue entre une parodie, teinté d’admiration, et une actualisation de ces codes face à une société, devenue un spectacle perpétuel, qui s’effondre dans l’ineptie et la bouffonnerie. D’autre part, Under the Silver Lake s’inscrit dans la lignée des œuvres à la Mulholland Drive (David Lynch, 2001) tout en écartant sa dimension métaphysique pour accoucher d’enjeux intrinsèquement contemporains : la lente apocalypse d’un monde en perte de sens. Se jouant d’un spectateur à la fois désillusionné et biberonné aux discours ontologiques, David Robert Mitchell oscille entre démence et véracité pour construire un territoire cinématographique encore vierge perdu entre le non-sens instinctif et la surinterprétation mécanique.

4. Les Garçons sauvages, Bertrand Mandico
(France)
Récit homérique, Les Garçons sauvages est une épopée transgenre qui décompose et redessine, avec luxure, les repères sexuels et cinématographiques. Pour son premier long-métrage, Bertrand Mandico se joue de la matière – celle des corps de ces jeunes garçons métamorphosés en femme au contact d’une île-matrice, celle de la pellicule qui foisonne de trouvailles – pour créer un univers atypique et novateur dans un cinéma français de plus en plus frileux. Par ce tourbillon pulsionnel et onirique, le cinéaste illustre une certaine imagerie sexuelle freudienne en prônant une sexualité infantile mêlant jeu (cette décadente répétition théâtrale qui ouvre l’œuvre) et la découverte du plaisir (par cette île fantasmagorique de laquelle s’échappe une semence exquise). Expérimentation à la Georges Méliès autant que récit de piraterie à la Raoul Ruiz, Bertrand Mandico renoue avec un cinéma d’avant-garde actualisé à l’aune d’un discours politique queer et libérateur.

3. Les Âmes mortes, Wang Bing
(Chine)
Les Âmes Mortes marque la tragique mise en crise du dispositif cinématographique de Wang Bing qui, à l’accoutumée, abolit un certain didactisme documentaire (annihilation de la voix-off ou du format de l’entretien). Observateur infatigable, le cinéaste chinois expose une image sacro-sainte qui, par sa frontalité brute, révèle les gestes, au sens littéraire également, des marginaux de la Chine contemporaine. S’efforçant d’atteindre une subjectivité paroxysmique, il se heurte ici à une triple annihilation : celle des esprits orchestrés par Mao Zedong (par les mouvements antidroitiers de 1957-1958), celle des corps dans les camps de rééducation communistes, et celle de la mémoire étatique (par la destruction institutionnalisée des camps et des mémoriaux) et individuelle (par le compte à rebours biologique de ces survivants). Comment filmer ce qui n’existe plus et surtout garder ce qui est en train de disparaître ? Le documentariste façonne, à travers ses entretiens, un lieu de sépulture pour ces âmes errantes pour empêcher, indéfiniment, l’oubli souhaité par les pouvoirs politiques chinois.

2. Sophia Antipolis, Virgil Vernier
(France)
Dans Sophia Antipolis, Virgil Vernier traque un reliquat d’utopie dans cette réalité morose, voire sinistre. Il s’enquiert des miettes d’un paradis onirique là où l’individu, et par extension le spectateur, s’y attend le moins : dans une zone industrielle où des paons sauvages laissent derrière eux des plumes ; dans le fond d’un bus où un petit garçon propose des tours de magie ; dans une expérimentation cosmique qui se dissout dans la pellicule. En refusant tout schématisme ou misérabilisme, le cinéaste convoque les chimères du présent et renoue avec l’idéal pasolinien d’une œuvre d’intervention politique qui l’est, justement, parce qu’elle est son propre manifeste poétique. (Critique)

1. Seule sur la plage la nuit, Hong Sang-soo
(Corée du Sud)
Les œuvres les plus sublimes d’Hong Sang-soo sont celles qu’il nimbe d’une douce, néanmoins amère, mélancolie amoureuse. Envahi par le spleen, le prolifique cinéaste sud-coréen renchérit le deuil amoureux de Young-hee (Min-hee Kim) d’un cortège d’actes de grâce, comme ses personnages s’agenouillant avant de traverser un pont. D’une poésie inextinguible, le cinéma d’Hong Sang-soo déconstruit, au moyen de frontières (scénaristiques) traversées par des fantômes, les liens entre le rêve et la réalité. Accordant une place à l’invisible, il poursuit sa fuite sentimentale vers les limbes d’une utopie amoureuse survivant dans les rêves, conscients ou non, de sa muse. Le cinéaste livre ainsi une éblouissante déclaration d’amour d’un territoire qui ne croit plus en l’amour.

Le Cinéma du Spectateur