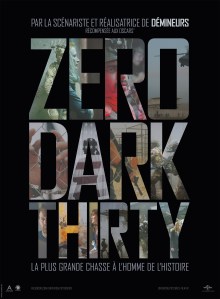Le « désenchantement du monde » théorisé par Max Weber marque le recul de la superstition, des croyances et de la religiosité des sociétés occidentales. Le cinéma n’a pas attendu 2012 pour traiter la question de la religion. Cependant, c’est dans le fond de la critique qu’il faut voir un renouveau. M.A.S.H (1970) de Robert Altman ironisait sur l’apport illusoire de la Religion dans le milieu humain qu’est la guerre, mais ce n’est qu’un épisode presque mineur de cette satire. On peut également penser à Amen (2002) dans lequel Costa-Gavras s’attaque à l’inaction de la Chrétienté durant le génocide juif de la Seconde Guerre mondiale, cependant ce sont les actions de la Religion et non sa nature propre qui est remise en cause. Le cinéma a été, au cours de l’année qui s’est écoulée, intransigeant envers la religion et ses conséquences dans les sociétés actuelles. Il ne faut pas voir là une émancipation ou un athéiste cinématographique mais seulement une nécessité d’analyser la société par ses éléments fondateurs. La Religion ne dispose plus de cette sacro-sainteté qui empêchait tout regard critique. Cette mise à nue permet d’ouvrir les yeux sur les dérives de la religion, mais surtout sur le leitmotiv lancé par le cinéma : la Religion est obsolète !
Le Cinéma, comme la Religion, trouve son essence dans l’auditoire présent. Un auditoire fidèle et discipliné qui accepte de recevoir la Parole sans chercher la vraisemblance du récit. C’est sur cet aveuglement que fonctionne L’Odyssée de Pi (2012) d’Ang Lee qui montre au travers de sa beauté visuelle une présence divine. « Vous croirez en Dieu après que je vous ai raconté mon histoire » avertie même le narrateur. Ang Lee crée une symbiose entre le Céleste et le Terrestre par le biais d’une mer-miroir qui permet au récit de s’engouffrer dans les confins de l’imaginaire. Cependant notre intérêt se porte sur la première partie du film, c’est-à-dire sur les péripéties religieuses et formatrices du jeune Pi qui se conclue d’une manière cocasse: « Je suis un bouddhiste-musulman-chrétien ». De cet amalgame d’histoires religieuses sort des recoupements et des similitudes qui ancrent la Religion dans une logique de contes multiples. Ainsi, elle se place seulement au rang de croyance et non de vérité. Cette pensée est personnifiée à travers le rationalisme du Père qui prône une croyance en la Science. La Mère ne défend d’ailleurs que la Religion pour ce qu’elle apporte à l’imagerie de l’enfant : « C’est bon pour lui à son âge ». De son côté, Abel Ferrara réduit dans son film apocalyptique 4h44, Dernier jour sur terre (2012) la religion à la masse ne montrant non plus des figures humaines mais des ouailles regroupées dans les clôtures que forment les lieux saints. Le réalisateur américain dépeint une humanité qui ne voit dans la religion que le moyen d’assouvir sa soif d’immortalité et ne trouve donc là qu’une solution pour l’au-delà. Même ses personnages marginaux tombent dans les affres du spirituel s’enlaçant une dernière fois bordés par le serpent ancestral qui marque les confins du monde.

4h44, Dernier jour sur terre, Abel Ferrara (Etats-Unis, 2012)
De la puissance coercitive de la Religion, Rachid Djaïdani tire une histoire d’amour maudite entre un chrétien noir et une musulmane par une religion castratrice et dominante. Le problème n’est plus la croyance mais le sectarisme qui en découle dans nos sociétés. Rengaine (2012) est donc le symbole de ce communautarisme extrême qui empêche l’émergence d’une culture multi-ethnique à l’identité propre. Il tourne alors en dérision la rengaine française : Liberté, Egalité, Fraternité. Cristian Mungiu (Au-Delà des Collines, 2012) s’insurge aussi de voir une Orthodoxie dictatoriale et réfractaire bloquer la quête de rationalité de son pays, la Roumanie. Si le village aux allures de vestiges médiévaux est « au-delà des collines », c’est pour mieux montrer que la Religion ne doit plus faire partie de la vie civique. Elle est attachée à l’obscurantisme passé faisant des protagonistes les véritables martyres. L’aberration saisit le spectateur lorsqu’un médecin propose de soigner une malade non pas par la médecine mais par la lecture de psaumes. Mungiu clôt son film sur la mise en accusation d’un Religion trop souvent blanchie. Une scène du long-métrage Les Hauts du Hurlevent (2012) d’Andrea Arnold fait d’ailleurs un intéressant rapprochement entre la Religion et l’esclavage. Modifiant l’histoire en faisant d’Heatcliff un jeune noir probablement ancien esclave, la réalisatrice britannique montre la violence par laquelle la religion s’impose dans la vie des hommes. Ce baptême forcé lors duquel Heatcliff est violemment pris par le cou, plongé et maintenu dans l’eau bénite fait alors échos à ses précédentes tortures. La Religion n’est souvent pas un choix volontaire mais le fruit d’une socialisation dans le domaine privé. Les membres spirituels contraignent alors à la croyance et place sous le drapeau de la religion de nombreuses exactions : les croisades évangélistes, massacres orchestrés pour et par la Religion.

Au-delà des Collines, Cristian Mungiu (Roumanie, 2012)
Néanmoins, le Cinéma ne tente nullement de prendre la place de la Religion en devenant un médium divinatoire qui prônerait une attitude à suivre. Il ne constate que les carences de l’immuable institution religieuse. Certes à travers Prometheus (2012), Ridley Scott crée sa propre théologie partant à la recherche de nos créateurs. Il survole alors les débats pour nous proposer sa version de la création de l’homme. Il s’inscrit donc dans la lignée des faiseurs de mythe en privilégiant le fantastique. Ce qu’il faudrait retenir de cette année anticléricale, c’est une réflexion sur la place qu’occupe la religion dans nos sociétés. Elle est nécessaire à l’homme qui se rattache tant bien que mal à sa condition de mortels comme chez Ferrara, mais elle ne doit plus être un des piliers de notre culture. Il faut enclencher un basculement de la sphère publique à la sphère privée.