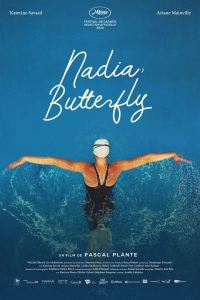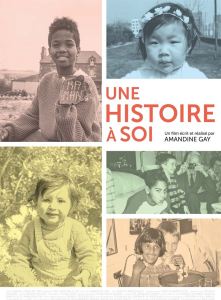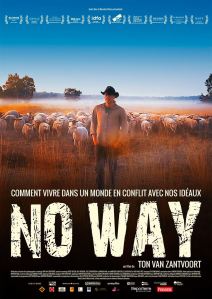10e Champs-Elysées Film Festival
Prix du Jury – Meilleur long-métrage français
Sortie le 8 décembre 2021
Tandis que l’urbanité de la ville de Paris s’estompe au fur et à mesure des plans, le Bois de Boulogne se déploie. Comme dans un conte, une voix sibylline appelle le.a spectateur.rice à pénétrer dans cette forêt. Sous les mots douloureux de « O fado de cada um » (écrits par Silva Tavares et popularisés par Amália Rodrigues), une contre-société sylvestre prend forme devant la caméra de Claus Drexel. Dans Au cœur du bois, la forêt renoue avec sa force romanesque. En-chantée, elle s’impose comme une altérité spatiale radicale, constituant à la fois un refuge et un lieu de mise à l’épreuve. Terrain de jeux des Parisiens (équitation, piscine, footing), le Bois de Boulogne est, dans le labyrinthe de ses chemins sinueux, un espace de liberté pour ses habitant.e.s qui se réinventent sous l’égide de leur propre flamboyance. Terrain de « je » pour elleux, la forêt s’exprime alors comme un lieu de construction d’une identité réelle, par et pour soi. Malgré cela, cette liberté espérée les contraint socialement à s’enfermer dans les méandres du bois et à trouver dans la prostitution leur seul moyen de survivre.

Avec Au cœur du bois, Claus Drexel recueille une parole libertaire, et libératrice pour ses locuteur.rice.s, luttant contre l’invisibilisation des travailleur.euse.s du sexe. Sous forme d’entretiens où la présence du documentariste s’efface, les protagonistes offrent une parole inestimable dans laquelle naissent et s’entrecroisent des quêtes de repères et d’épanouissement, germant sous les marques indélébiles de la transphobie, de l’homophobie et de la misogynie. La force d’Au cœur du bois est de ne jamais construire un discours uniforme et essentialiste sur son sujet. Le documentaire se nourrit de la multiplicité des parcours qui oscillent entre la démonstration d’une force politique émanant du simple choix d’exister et le jaillissement de failles intimes dissimulées, consciemment ou non, dans un rapport à la norme (qu’iels combattent autant qu’iels fantasment). Alors que le nombre de travailleur.euse.s du sexe dans le Bois de Boulogne décline et que le sentiment de solidarité se dégradent, iels luttent ensemble à la manière de ce « todas » qui les unit dans la nuit lorsqu’un.e a des problèmes.

Grâce à Au cœur du bois, Claus Drexel dessine un portrait de la prostitution dans le Bois de Boulogne et en épouse la pluralité : d’une part, celleux qui racolent sur le bord de la route et continuent d’arpenter le bois, de nuit ou de jour, alors que l’hiver se montre de plus en plus rigoureux ; d’autre part, celleux qui, depuis l’intérieur de leur camionnette dont les néons – sublimés par la photographie de Sylvain Leser – tranchent dans la nuit, craignent les altercations avec les policiers. Véritable mémoire du bois, iels édifient à travers leurs souvenirs une importante histoire de la prostitution en France. De la loi « Marthe Richard » (1946) qui entraîne la fermeture des bordels à la loi décriée du 13 avril 2016 qui instaure la pénalisation des clients, les protagonistes d’Au cœur du bois témoignent d’une précarisation constante des travailleur.euse.s du sexe. D’abord considéré.e.s comme indigent.e.s (et ayant un accès gratuit aux services de santé), iels sont devenu.e.s des parias imposables sous François Mitterrand, puis des délinquant.e.s condamnables sous Nicolas Sarkozy. Révéré.e.s par le cinéma éthique et politique de Claus Drexel, iels affirment leur utilité publique autant dans une optique d’aide à la personne que dans celle de réceptacle cathartique des perversions humaines. Iels lèvent leur voix face à l’hypocrisie de leur propre clientèle : policiers, militaires et politiciens.
Le Cinéma du Spectateur
☆☆☆ – Bien