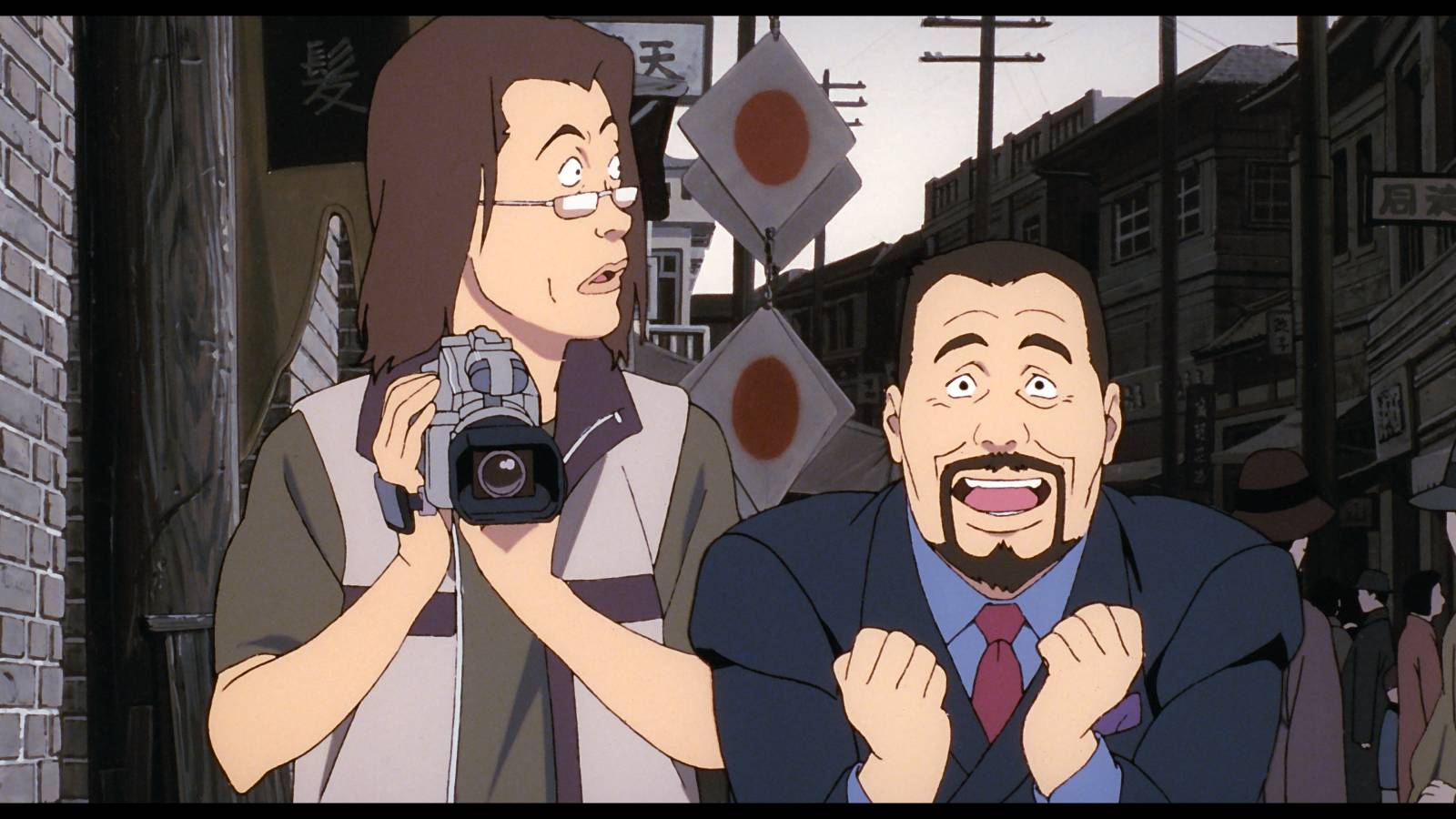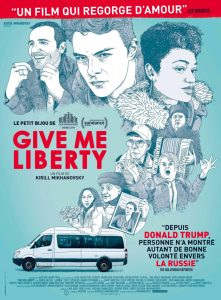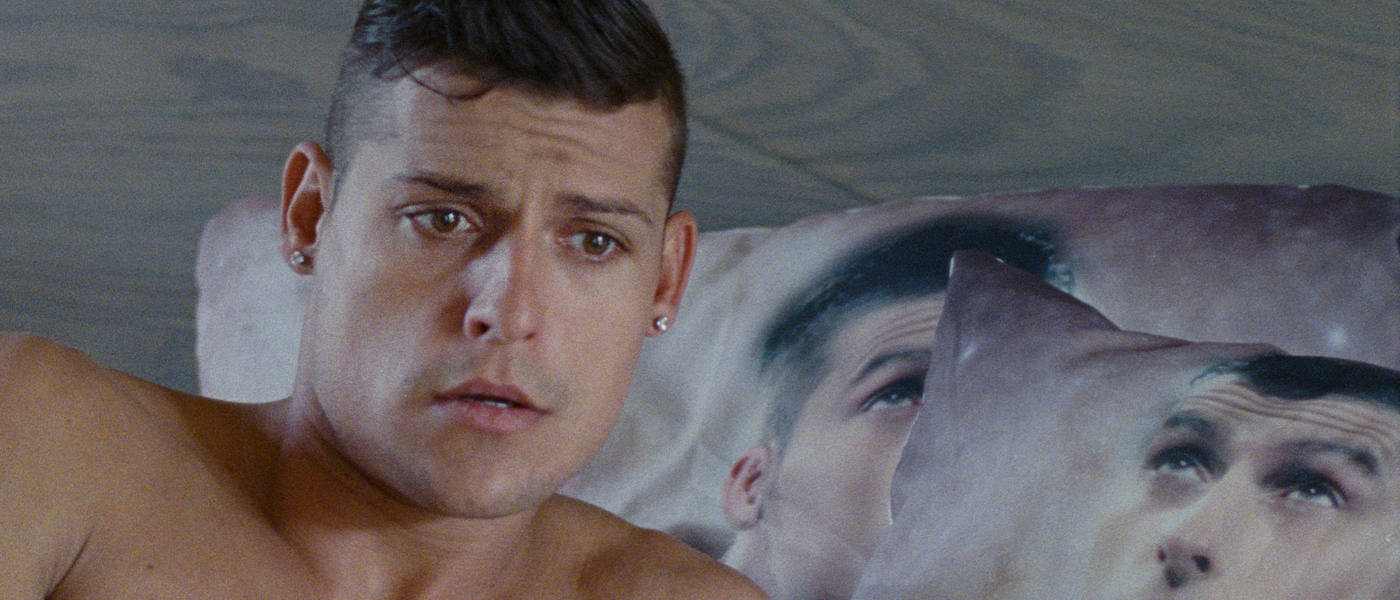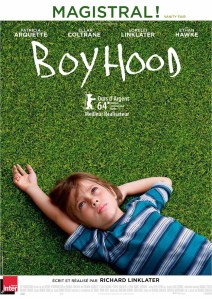70e Festival de Berlin
Mention spéciale du jury – Génération
Sortie nationale le 19 août 2020
Dans Mignonnes, la frontière entre dénonciation de l’hypersexualisation des jeunes filles et reproduction des poncifs archétypaux sur le sujet est ténue. Afin de rendre son œuvre sur-signifiante sur la question autant formellement (le clip comme forme d’expression « jeune ») et scénaristiquement (questionnement sur la place de la femme dans une société patriarcale), Maïmouna Doucouré sacrifie la riche complexité de la nuance afin de présenter un réel binaire. À travers le récit initiatique d’Aminata (« Amy »), Mignonnes revendique une liberté du corps féminin devant s’émanciper à la fois d’un regard (pédo)pornographique machiste et d’un assujettissement religieux. Entre le visionnement de vidéos sexuellement explicites et le discours théologique sur la place des femmes, Amy (Fathia Youssouf) intériorise une vision diabolisée du corps féminin – qui devra aller jusqu’à l’exorcisme. Le vêtement devient alors la pièce maîtresse du discours de la cinéaste qui en fait le symbole d’une libération sexuelle et identitaire faussée s’opposant à la rigidité d’une robe traditionnelle apportée pour le second mariage de son père (se teintant de sang lors d’une séquence onirique).

Néanmoins, Mignonnes repose sur la dichotomie passéiste entre d’un côté la femme puritaine (religieuse) et de l’autre la femme putain (« occidentalisée »). Maïmouna Doucouré reproduit alors sa propre critique en proposant une vision radicalement binaire de la femme qui ne peut qu’être garante de la moralité (par le rôle de la « tante ») ou signe de perdition (Amy). L’émancipation tardive de Mariam, la mère d’Aminata (Maïmouna Gueye), par rapport à la « tante » ne permet pas de sortir de cette dualité féminine. Le montage alternant les plans d’une prière musulmane, féminine et collective, et ceux d’une vidéo de danse sexualisée, qu’Amy regarde sous son voile, démontre la vision non-poreuse de la femme amorcée par la cinéaste. Sans véritablement offrir de troisième voie (ou du moins de personnages féminins moins archétypaux), Mignonnes ne reste finalement qu’une illustration plutôt que d’être un véritable manifeste politique et féministe.

Reprenant la trame scénaristique de son court-métrage Maman(s) – césarisé en 2017 – par l’arrivée prochaine d’une seconde épouse, Mignonnes ne présente la tradition qu’à travers le prisme de l’oppression nécessitant, pour Aminata, une fuite vers des codes occidentaux et machistes. D’une part, cette fuite de la communauté dissimule l’apport moral et social de ces communautés religieuses et/ou associatives pour les personnes issues de l’immigration et ce d’autant plus pour les femmes. L’inexistence de ce soutien (en dehors de celui moralisateur de la « tante ») questionne dans cette volonté de confronter gratuitement les possibilités de l’échiquier identitaire d’Amy en rejetant l’idée non-manichéenne d’une identité simplement multiple. D’autre part, la critique de Maïmouna Doucouré s’étiole en choisissant comme solution finale le fait que la protagoniste est encore trop jeune pour subir ces questionnements identitaires et sexuels. En dehors de la conclusion enfantine de Mignonnes, la cinéaste minimise ses propres enjeux féministes en les cachant derrière des problématiques éculées et hors propos qu’il s’agisse du fait que Amy cherche désespérément des ami.e.s ou que Angelica tente d’attirer l’attention de parents distants. Elle ne pointe jamais l’essence même des pouvoirs de domination qu’ils impliquent.

Mignonnes s’égare aussi lorsqu’il proteste contre la sexualisation des jeunes filles. En illustrant uniquement par le biais d’une mise en scène redondante la sexualisation d’une enfant de 11 ans, Maïmouna Doucouré ne questionne aucunement le regard qu’elle conteste – le male gaze – mais en reproduit les problèmes et son indigence. Cette candeur face à la mise en place d’un discours « politique » par sa simple reproduction, voire son outrancière amplification, se rencontre principalement dans l’omission des véritables enjeux de censure du corps féminin dans l’espace public. L’intrigue de l’œuvre avance à deux reprises par le biais des réseaux sociaux : lorsqu’Amy découvre une vidéo des danseuses rivales finissant par le dévoilement, faussement ingénu, d’un sein faisant de la sexualité un moyen de médiatisation ; et lorsqu’Amy poste une photographie de son vagin sur Instagram (non-censurée) pour palier à sa réputation d’ « enfant » suite à l’apparition de sa culotte. Ces deux « bouleversements » sont rendus caducs par l’ignorance, dans le film, de la censure imposée au corps féminin sur les réseaux sociaux – le personnage de Coumba disant à Amy d’aller voir les commentaires sous sa photographie des jours après sa publication n’offre aucune réflexion sur la censure imposée au corps féminin et à la pédopornographie.

Paré d’intentions louables, Mignonnes de Maïmouna Doucouré est finalement une œuvre assez inoffensive qui en se focalisant que sur le ressenti du personnage d’Aminata ne parvient pas à aller au-delà de la simple démonstration d’enjeux la dépassant. L’œuvre manque cruellement d’une subtilité qui aurait évité l’imposition artificielle d’un dilemme « cornélien » à son héroïne partagée entre deux modes de vies se retrouvant maladroitement sur la même tranche horaire d’une matinée lambda – d’un côté une audition de danse, de l’autre les préparatifs du deuxième mariage de son père.
Le Cinema du Spectateur
☆ – Mauvais