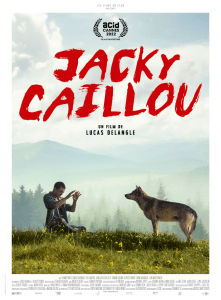73e Berlinale
Forum
Sortie le 6 septembre 2023
Dans un fier panoramique vertical, le quartier des bois du temple se manifeste par ses imposantes tours. Depuis la hauteur d’un balcon, un homme – Pons (Régis Laroche) contemple la ville de Clichy-sous-Bois, dans la banlieue parisienne, et sa visible ségrégation sociale. Le centre-ville paraît loin, Paris inaccessible. Alors que le temps paraît suspendu, les sirènes d’une ambulance troublent cette tranquillité – si rare dans la banlieue fantasmée du cinéma français. Elle témoigne de la mort naturelle de la mère de Pons, une vieille femme aimée du quartier. Quelques échanges imperceptibles avec les ambulanciers, puis ces derniers entrent dans la chambre mortuaire. L’ancien militaire, comme le·a spectateur·trice, reste à la lisière de cette chambre, à la lisière de la mort. Si un léger zoom nous invite à franchir le pas, Rabah Ameur-Zaïmeche nous retient parmi les vivant·e·s. La mort, et son deuil, s’évapore doucement dans les gestes des vivant·e·s dont l’efficacité témoigne d’une minutie acquise par leurs inlassables répétitions : sangler le corps inerte sur la civière, baigner le cercueil dans la fumée des encens, accueillir contre une soutane un·e proche sanglotant, chanter une chanson en souvenir de la défunte.
Si les esprits sont à l’arrêt, les corps continuent d’avancer – comme un devoir envers les mort·e·s. Chez Rabah Ameur-Zaïmeche, l’action est une habitude, comme un réflexe. Lorsqu’un braquage auprès d’un prince arabe se met en place entre différents membres de la cité, il est filmé comme une chorégraphie refusant tout spectaculaire ou sensationnalisme. Il est bref, efficace, sans accroc. Il se déroule sur le périphérique, en marge d’un monde qui les renie. En quelques secondes, ils inversent les rôles sociaux, dérobent l’argent et le pouvoir. Dans cette temporalité écrasée par le présent, l’excitation et la joie ne peuvent exister – perte de temps. Elles éclateront plus tard, cachées derrière une course hippique télévisée dans le café du quartier. En lisant dans un journal un article sur le braquage, les habitué·e·s du café s’enorgueillissent ensemble de la nouvelle. Participants dissimulés ou client·e·s, il s’agit d’une victoire contre l’ordre capitalisme établi. La célébration que certain·e·s, peut-être, pourront sortir de leur condition.
Alors que les représailles d’un prince arabe hors du temps se préparent, les discrets braqueurs rêvent d’un avenir qui, même dans cet exploit, doit rester simple : l’un rêve d’une lune de miel au Brésil, l’autre d’une main mécanique pour remplacer celle perdue. Pour ne pas être arrêté, il est nécessaire de ne pas sortir publiquement de sa condition sociale, de ne pas rendre sa richesse visible, de garder les atours d’une pauvreté intrinsèquement invisibilisante. Dans Le Gang des bois du temple, la parole permet de partager autant un passé commun que d’imaginer un futur hypothétique. Territoire d’espoir, cette parole dresse le portrait d’une communauté, unie par une bienveillance partagée. La banlieue de Rabah Ameur-Zaïmeche est une banlieue qui existe pour et par elle. Il déconstruit la vision classiste, raciste et misogyne d’une banlieue peuplée d’Apaches – ces habitant·e·s immoraux des faubourgs fantasmé·e·s par la littérature et le cinéma français afin d’émoustiller l’ordre bourgeois. Le cinéaste humanise, dans le sens qu’il donne chair et voix, des destinées alternatives qui fleurissent à la lisière de la société.
Alors que l’implacable machine sociale broie les différents membres du gang, Rabah Ameur-Zaïmeche ne filme pas frontalement les exactions – dont le voyeurisme le placerait du côté du monde bourgeois. Il cherche un souffle de vie perpétuel qui maintient le rythme d’un quotidien socialement étouffé. Le banditisme de Le Gang des bois du temple n’est qu’une activité annexe. Le cinéaste capture un quotidien précieux où ses protagonistes parlent, rêvent, lisent des histoires à leurs enfants. Les cercles familiaux et amicaux deviennent les refuges du vivant alors que les morts et les arrestations bousculent leur réel. Iels prolongent un mouvement vital qui se déchaîne entre les murs d’une cité protectrice. Lors d’une arrestation, la voiture de la police est filmée depuis le hall d’un des immeubles. La prochaine apparition du personnage se fera entre les murs d’une prison, alors que sa compagne guide le spectateur·trice vers le parloir. Cet ellipse synthétise la malédiction imposée aux hommes de banlieue – dont la présence dans l’espace social est impossible. Heureusement, Rabah Ameur-Zaïmeche leur permet d’exister dans leur complexité en dehors de tout carcan préétabli par la société française et le cinéma bourgeois qui en découle.
Le Cinéma du Spectateur
☆☆☆☆☆ – Chef d’Oeuvre