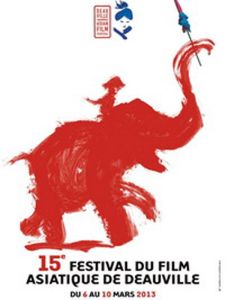Au début de l’année 2015, Réalité (Dupieux, France) apparaît comme un manifeste dans sa réaffirmation de l’image, dans sa simplicité, comme langage fantastique proprement cinématographique. En entremêlant réel et fiction, il forme un labyrinthe fantasmagorique où les créateurs et les monstres (les télévisions exploseuses de cervelles) jouent sur le même de degré de réalité. Il y a une autonomisation du récit filmique où le fantastique joue le rôle de déclencheur à l’instar de l’ouverture de Fou d’Amour (Ramos, France). La tête fraîchement tranchée d’un curé (Melvil Poupaud) transgresse les règles de la vraisemblance pour raconter ce qu’il a amené à être jugé par des hommes face à des spectateurs jouant le rôle de Dieu au moment du jugement dernier. Les éléments fantastiques trouvent alors une existence à nu, sans l’appui des effets spéciaux, pour devenir non plus un gadget, mais une réalité alternative acceptée par le spectateur. Selon cette idée, Vincent n’a pas d’écailles (Salvador, France) présente le premier super-héros sans trucage numérique. Ce premier film inscrit son univers fictionnel, cinégénique, dans la réalité d’un village rural. De cette volonté de rendre tangible l’intangible, Vers l’autre rive (Kurosawa, Japon) tire sa force et sa beauté. Ses fantômes sont des êtres sensibles et palpables qui subliment une réflexion onirique sur la souffrance du deuil vue comme la perte d’un sens premier, le toucher, entre des corps réels et absents. Dans Les Nuits blanches du facteur (Kontchalovski, Russie), la confrontation s’étend aux espaces qui se nourrissent, lors d’une scène en barque entre Alexei et son jeune voisin, des mythes faisant de la forêt le sanctuaire d’une créature magique. La magie et la peur se lient par la force paradoxale de la suggestion, de l’invisible.

La disparition est un élément central d’un cinéma cherchant une spiritualité ou une histoire disparue. Les corps évanescents des soldats de Ni le Ciel Ni le Terre (Cogitore, France) font écho aux différentes représentations du monde, l’ultra-rationalisme des Occidentaux et l’imaginaire de croyances des bergers afghans. Chacun cherche une vérité, sa vérité, face à un destin onirique échappant aux contrôles des hommes.Valley of Love (Nicloux, France) rejoint cet aveuglement rationnel face à l’absence avec ce couple séparé depuis des années, formé par Huppert et Depardieu, qui se retrouve dans la Vallée de la Mort pour attendre le retour de leur fils mort depuis 6 mois. Le corps absent joue le rôle de créateur de vie, un appui pour entamer une reconstruction personnelle et mentale. Il y a l’idée qu’il faut voir pour croire, que l’image rétinienne ou filmique apporte une vérité, une explication sur le monde qui nous entoure. Avec Le Dernier Jour d’Yitzhak Rabin (Israël), Amos Gitaï fait du corps supprimé du Premier ministre israélien une source d’interrogations politique et cinématographique qu’il résout en créant un dialogue entre les images réelles (archives) et les images fictionnelles (reconstitution). L’image cinématographique remplit les vides de l’Histoire. Ce rapport cinéma/histoire pose la question du travail de la mémoire au sein de l’image, mais aussi des actions des protagonistes. Dans Le Fils de Saul (Nemes, Hongrie), Saul (G. Röhrig) lutte, non plus pour la survie des corps, mais pour la survie mémorielle d’une communauté vouée à disparaître. Le corps comme transmission se retrouve dans un scène sublime de Cemetery of Splendour (Weerasethakul, Thaïlande). A travers le corps de deux femmes dont l’une médium, les époques dialoguent. Une forêt se transforme, par la force de l’esprit, en ancienne résidence princière. Leurs corps ne répondent plus au temps présent, mais à celui du passé : parties dans un réalité autre que celle du spectateur, elles esquivent des poutres invisibles, cherchent des portes absentes et regardent des trésors déjà disparus.

L’année 2015 est parcouru ainsi par la nécessité de (re)créer une mythologie à des sociétés désubstantialisée par la crise mondiale. Avec ses récits des Mille et Une Nuits (Portugal), Miguel Gomez offre à son pays sclérosé un nouvel imaginaire, une nouvelle échappatoire : les prisonniers de la crise rêvent de faire chanter les oiseaux tandis que les djinns prennent leur envol ou le fantôme d’un chien devient le lien qui unit les habitants d’un immeuble. Au-delà des Montagnes (Zhang-Ke, Chine) suit la même logique en créant une épopée moderne autour des démunies de la mondialisation, les provinciaux chinois. Oeuvre à dimension prophétique, elle scelle le destin d’un pays qui disparaît, comme sa langue et ses racines dans la 3e partie se déroulant en 2025, face à son expansion exponentielle. Ce volonté de rattachement au passé qui nourrit le personnage de Dollar (D. Zijian) obsède également le journaliste Ibn Battutâ de Révolution Zendj (T. Teguia, Algérie/Liban). Après un reportage sur des affrontements communautaires au sud de l’Algérie, il part sur les traces de révoltes oubliées du IXe mettant en résonance le passé et le présent. Histoire de Judas (Ameur-Zaïmeche, France) tient sa force également de la juxtaposition de temporalité avec sa réécriture de l’épisode de l’arrestation de Jésus-Christ. Les personnages s’inscrivent dans les palais en ruine montrant la chute future de ceux qui dominent alors le monde, les Romains. Ces différents films défendent la capacité du cinéma à porter les espérances d’un peuple, d’une société ou de l’humanité tout entière. Taxi Téhéran (Panahi, Iran) montre, en jouant sur les rapports entre le réel et la fiction, la nécessité de s’approprier les images (en tant que cinéaste, mais aussi simplement en tant que spectateur ou pirate) pour créer un discours, une mythologie, propre à soi.

Le cinéma documentaire a aussi été parcouru par cette volonté de s’approprier les évènements traumatiques de l’Histoire pour donner corps et image aux disparus. Le Bouton de Nacre (Guzman, Chili) trouve sa grandeur dans ses passerelles entre le massacre des Amérindiens et celui des opposants à la dictature au Chili. Le cinéma de Guzman est profondément mémoriel en servant de témoignage pour le futur (la beauté du récit de voyage d’une vieille Amérindienne dans sa langue natale vouée à s’éteindre) et pour le passé (la reconstitution avec un mannequin du processus de disparition des corps sous Pinochet). Dans Parole de Kamikaze (Sawada, Japon), il y a également une reconstruction, distanciée par le biais de jouets, de la manière dont les kamikazes attaquaient les navires ennemis fait par celui qui choisissait ceux qui allaient mourir. Le réalisateur confronte ainsi le bourreau à des corps absents déjà engloutis par la guerre. Joshua Oppenheimer (The Look of Silence, Danemark/Indonésie) organise, quant à lui, véritablement une confrontation entre les bourreaux et le frère d’une victime lors de l’ « épuration » idéologique de 1965 en Indonésie. Au lieu de reconstruire des évènements, Aleksandr Sokurov s’attèle à reconstruire des hommes dans Francofonia. Dans le Paris de 1940, il retrace la rencontre entre Jacques Jaujard, directeur du musée du Louvre, et le comte Franz von Wolff-Metternich, chef de la Kunstschutz, qui s’unissent pour préserver les collections du musée. Dans une scène grandiose, Sokurov supprime la distance de la reconstitution en filmant les deux hommes frontalement pour leur raconter en voix-off leur futur : l’oubli pour le premier, la reconnaissance pour le second. Il montre que l’Histoire n’est pas une réalité, mais véritablement une construction qui choisit, parfois maladroitement, ses figures et ses héros.

Une oeuvre semble être à contre-courant de cette volonté d’un réalisme social et historiciste, Mia Madre (Moretti, Italie). En montrant par le biais du film réalisé par sa protagoniste (Margherita) l’impossibilité d’un cinéma politique, Nanni Moretti se focalise sur la sphère intime ébranlée par les derniers jours d’une mère mourante. Régi par les sentiments dont la peur du deuil et de sa propre mort, le film questionne le réel, l’altère et le déforme. Les personnages cherchent une échappatoire face à l’inévitable : un moyen de se détacher du sol de la même manière que Sangaïlé (J. Steponaityte) dans Summer (A. Kavaïté, Lituanie). De s’émanciper du monde, de ses enjeux politiques ou sociaux, pour partir à la conquête du sentiment pur !
Top. 10 :
1. Cemetery of Splendour, Apichatpong Weerashetakul (Thaïlande)
2. A la folie, Wang Bing (Chine)
3. Mia Madre, Nanni Moretti (Italie)
4. Les Secrets des Autres, Patrick Wang (Etats-Unis)
5. Le Bouton de Nacre, Patricio Guzman (Chili)
6. Les Mille et une nuits, Miguel Gomez (Portugal)
7. Tangerine, Sean Baker (Etats-Unis)
8. Le Dernier jour d’Yitzhak Rabin, Amos Gitaï (Israël)
9. Il est difficile d’être un Dieu, Alexei Guerman (Russie)
10. Taxi Téhéran, Jafar Panahi (Iran)
Le Cinéma du Spectateur