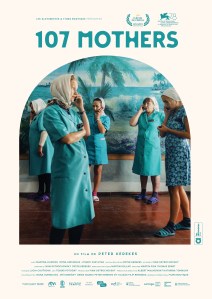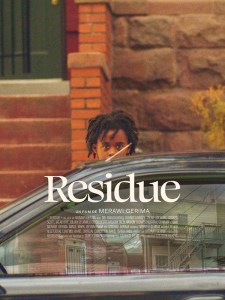79e Mostra de Venise
Fuori Concorso
Sortie le 16 août 2023
Dans l’une des salles de l’académie de police des Philippines qui ouvre Quand les vagues se retirent, une affiche remémore les paroles fictives d’Hercule Poirot, « on doit chercher la vérité au-dedans et non au-dehors ». Installée au sein de la plus haute institution policière du pays, cette maxime simpliste prend un double sens politique : les coupables ne sont pas à chercher en dehors de l’institution elle-même. L’œuvre de Lav Diaz s’imprègne de la noirceur historique répandue sous le mandat du président Rodrigo Duterte (2016-2022) et, plus précisément, de son « opération Tokhang » – la mise en place d’une tuerie de masse (plusieurs milliers de mort·e·s) orchestrée par le gouvernement philippin sous couvert d’une lutte antidrogue. Dans le réel comme dans la fiction, les rues de Manille se remplissent de cadavres accompagnés d’un bout de carton sur lequel est écrit « je suis vendeur·euse de drogue, ne faites pas comme moi ». Comme le non-fictif photographe de presse Raffy Lerma (interprété ici par Dms Boongaling) dont il reprend les clichés, Lav Diaz cherche à appréhender le chaos sociétal dont ses images sont le symptôme et qui fige ses concitoyen·ne·s dans la posture d’inconsolables pietà.
Au cœur de cette quête du mal rongeant les Philippines, Quand les vagues se retirent lie le destin de deux (ex-)figures d’autorité : le lieutenant Hermes Papauran (John Lloyd Cruz) – déchu de ses fonctions pour coups et blessures ; et l’ancien sergent, et mentor d’Hermes, Primo Macabantay (Ronnie Lazaro) – finissant une peine de dix ans et toujours au service de la pègre que représente le gouvernement philippin. Lav Diaz les insère dans un « royaume de la folie », pour reprendre les termes de la centrale discussion entre Raffy et Hermes sur l’origine d’une violence devenue un moyen de survivre face au fascisme. Alors que la culture du meurtre devient le système, les personnages errent dans une ville habitée que par sa propre décadence. Si les corps dansent, ils sont assujettis aux assauts frénétiques d’une hystérie sous-jacente. L’ivresse d’une joie feinte se lit sur des visages déjà absents. Dans ce territoire possédé, la rédemption n’est qu’une folie de plus proférée par les mains mortifères de Primo, depuis peu fanatique de Jéhovah. Rédempteur autoproclamé, il impose par la force – le baptême se transformant en torture – une moralité condescendante basée sur les soi-disant péchés inhérents à la pauvreté des individus qu’il rencontre sur son chemin (un batelier, une prostituée, une paysanne).
Habituellement adepte de la couleur – notamment pour ses films retraçant l’histoire passée du pays, Lav Diaz piège ironiquement le présent des Philippines dans un noir et blanc rugueux somptueux, façonné par les grains du 16 mm. Livré·e·s à leur solitude, les protagonistes sont prisonnier·e·s d’images où l’horizon, autant terrestre que mental, est aveuglé par la lumière implacable du jour et annihilé par les ténèbres de la nuit. Dans des plans que le cinéaste philippin distend jusqu’à l’implosion, les corps se délitent dans le même fracas que les esprits. Le mal putréfie les chairs, à l’instar de la peau d’Hermes qui sous les effets d’un très sévère psoriasis prend l’allure d’un lépreux. Dans les Philippines dépeintes par Lav Diaz, l’espoir agonise lentement comme cette technique de combat au couteau louée par Primo pour étirer les souffrances de son adversaire. Cependant, Quand les vagues se retirent ne se réduit pas à un simple constat pessimiste. Si la lutte contre les forces armées philippines s’apparente au balayage infini de la sœur d’Hermes, Nerissa (Shamaine Centenera-Buencamino), pour désensabler la maison familiale, l’œuvre témoigne de l’hostilité tenace de Lav Diaz envers un système corrompu voué à l’autodestruction. Tel Primo, il hurle « j’emmerde les Philippines ! ».
Le Cinéma du Spectateur
☆☆☆☆☆ – Chef d’Oeuvre