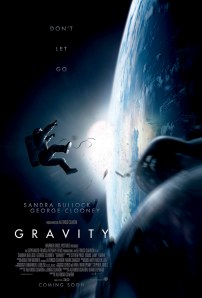FIDMarseille 2020
Compétition Internationale
Sortie le 29 décembre 2021
À près d’une centaine de kilomètres de Vientiane – capitale du Laos, des bateaux traditionnels en bois voguent sur les eaux paisibles du lac artificiel de la rivière Nam Ngum. Dans ce panorama où le bleu et le vert s’entremêlent, un élément rouge vrombissant rompt la quiétude. Escortée d’une musique pop assourdissante, la vedette d’un riche homme d’affaires chinois surgit tel un prédateur en acier au service d’un capitalisme homogénéisé. Sous l’égide du fameux mister Wong (Soulasath Saul), l’avenir économique du lac se dessine : muter en un paradis touristique international avec ses hôtels luxueux et sa trentaine de bateaux-restaurants. En posant sa caméra sur l’embarcation en bois de France (Nini Vilivong) – une jeune laotienne de retour sur sa terre natale pour assister sa famille qui dirige un modeste service de bateaux traditionnels, Kiyé Simon Luang se place du côté d’une immuable tradition directement menacée. Or, la beauté de la jeune femme détourne Tony Wong de ses velléités économiques et le confronte à la temporalité singulière de la vie sur les rives du Nam Ngum.
Dans Goodbye Mister Wong, la vie s’écoule dans une temporalité presque atemporelle, un temps géographique où la nature joue avec et se sert des différents personnages pour (re)construire sa propre mémoire. Kiyé Simon Luang développe un récit qui serpente et se multiplie dans les différentes strates historiques (les présences étrangères, française et chinoise) et sensorielles (l’attente commune du désir) du territoire. Qu’il s’agisse de Wong ou d’Hugo (Marc Barbé) – un français quitté depuis un an par sa femme, Nicole (Nathalie Richard), partie vivre sur une île reculée et inaccessible du lac, ils imposent une altérité que la puissance économique métamorphose en domination. Pour le premier, seul l’objet à s’approprier est interverti, du territoire au cœur de France. Pour le second, son statut de touriste occidental voyant le lieu uniquement à travers le prisme d’un exotisme de guide de voyages condamne ses interactions, à l’instar de cette séquence dans le bus où il s’évertue à parler français à une passagère lui rétorquant inlassablement qu’elle ne le comprend pas.
La dimension animiste de Goodbye Mister Wong se révèle lorsque Hugo décide d’arrêter de subir la distance imposée par sa femme, dont la présence énigmatique s’estompe dans la nature laotienne. Alors qu’il s’évanouit sous les rayons d’un soleil ardent, la rivière guide miraculeusement son bateau jusqu’au logis tant espéré. Lors d’une scène de mariage, il est prêché qu’il est nécessaire d’écouter le son du lac, chef d’orchestre des destinées alentour. Le territoire laotien resplendit dans les plans savamment composés de Kiyé Simon Luang et magnifiquement éclairés par les tons surannés de la photographie d’Aaron Sievers. Au sein des plans fixes que les personnages habitent momentanément par des dialogues succincts, seule l’inébranlable immensité du paysage s’imprime dans l’iris attentif du spectateur.trice. Pour les habitant.e.s du lac, le territoire est inscrit dans la mémoire immémoriale de leur corps à la manière de l’oncle Souck (Souvanlay Phetchanpheng) qui apprend à Toui (Thongmay Niyomkham) à naviguer en fermant les yeux. Pour les étranger.e.s – et par extension le.a spectatateur.rice, il faut s’abandonner à la langueur sereine du lac, se laisser avaler tout entier par ses eaux charriant en elles la beauté poétique et politique du peuple laotien.
Le Cinéma du Spectateur
☆☆☆☆– Excellent