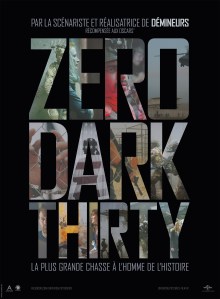Bien que naviguant dans un monde masculinisé au possible, Zero Dark Thirty fonctionne sur le visage d’une femme. Ce seront les courbes et les boucles rousses de Maya (Jessica Chastain) qui dénoteront dans l’univers clinique et épuré des bases militaires américaines. Kathryn Bigelow surprend par la distribution de son rôle puisque si la féminité avait déjà percée sa filmographie avec Blue Steel (1990), c’était par les traits masculins de Jamie Lee Curtis. Mais, elle dépasse les conventions en acceptant la beauté diaphane et sensuelle de son actrice dont les portes s’ouvrent par l’aide de sa condition de femme. Une femme belle certes, mais jamais potiche. La scène d’ouverture ne la ménage pourtant pas. En effet, pour son premier jour de torture, elle arbore sous sa combinaison un élégant tailleur signe d’un décalage entre le personnage et ce qui se joue devant elle. Au-delà de la traque, Zero Dark Thirty est le portrait de la métamorphose d’une femme qui s’en renier son sexe masculinise ses actions et son combat pour parvenir à ses fins. De la Maya effacée serrant ses mains de gêne de la scène d’ouverture, il ne restera que l’enveloppe charnelle. Pour réussir dans un milieu d’hommes, elle ne peut se permettre de montrer une seule faiblesse. C’est par son caractère, sa force et sa situation qu’il n’est pas absurde de voir dans Maya une allégorie même de la réalisatrice. Kathryn Bigelow est l’une des rares femmes-réalisatrices reconnues. Réfléchissez quelques instants pour trouver des noms de femmes réalisatrices : Jane Campion, Claire Denis. Si le cinéma est déjà masculin, le genre que choisit Bigelow l’est d’autant plus. Il faut dire que voyant l’homme en son sens le plus bestial, la réalisatrice américaine s’intéresse à l’effet de meute et d’admiration. L’homme devient homme et vivant par le groupe : c’est le cas des motards de The Loveless (1982) ou du gang de surfeurs de Point Break (1991).
 Ce n’est que depuis les années 2000 que Bigelow s’engouffre dans le monde, toujours plus masculin, du militaire. Récompensée et ovationnée pour Démineurs en 2009, elle continue son regard si particulier sur la guerre et la politique américaine. Kathryn Bigelow n’est pas dans l’action mais dans la tension. Sa mise en scène est réussie car finalement elle est épurée de musique, d’effets de style. Le milieu de la guerre est froid et calculé, alors pourquoi vouloir l’embellir et ainsi le rendre grotesque. La scène de la prise d’assaut de la maison est quasi-exclusivement montrée par les lunettes à vision nocturne des soldats pour nous amener au plus près de l’action et alors de l’émotion. Bigelow se rapproche au plus près du cinéma journalistique cherchant à montrer le cœur de l’évènement sans l’auréoler d’une psychologie et d’une vie des personnages qui rendrait le film pesant.
Ce n’est que depuis les années 2000 que Bigelow s’engouffre dans le monde, toujours plus masculin, du militaire. Récompensée et ovationnée pour Démineurs en 2009, elle continue son regard si particulier sur la guerre et la politique américaine. Kathryn Bigelow n’est pas dans l’action mais dans la tension. Sa mise en scène est réussie car finalement elle est épurée de musique, d’effets de style. Le milieu de la guerre est froid et calculé, alors pourquoi vouloir l’embellir et ainsi le rendre grotesque. La scène de la prise d’assaut de la maison est quasi-exclusivement montrée par les lunettes à vision nocturne des soldats pour nous amener au plus près de l’action et alors de l’émotion. Bigelow se rapproche au plus près du cinéma journalistique cherchant à montrer le cœur de l’évènement sans l’auréoler d’une psychologie et d’une vie des personnages qui rendrait le film pesant.
 L’autre sujet central de Zero Dark Thirty, c’est bien sûr la question de la torture. Jusqu’où un Etat, ou une institution, peut aller pour avoir ce qu’il veut ? Jusqu’où l’horreur des actions commises peut faire contrepoids à l’horreur des moyens mis en place pour réclamer justice ? Kathryn Bigelow ne ménage pas son spectateur en le faisant entrer dès la première scène dans les techniques de torture. Encore une fois, sa mise en scène ne cherche ni à minimiser ni amplifier l’horreur, elle relate simplement les faits. Surgit alors la face inhumaine de l’homme, celle qui montre qu’il est son propre adversaire et qu’il n’est civilisé que lorsqu’il le désire mais reste finalement un animal social. « Votre ami est un animal » confesse à bout Ammar (Reda Kateb) montrant bien le caractère double de l’homme. L’homme est un loup pour l’homme. Kathryn Bigelow rend encore plus acide ce constat par les singes présents sur la base militaire. Alors que la caméra fait un travelling au milieu de prisonniers cagoulés et attachés dehors dans des cages sous le soleil du désert afghan, elle s’arrête sur une cage avec des singes qui sont choyés et nourris. Le tortionnaire n’éprouvera des émotions qu’à la mort de ses singes et non de l’un des siens. La question politique et morale de la torture surgit sur la scène internationale par l’épisode d’Abu Ghraib mentionné dans le film. En effet, cette vidéo montrant la maltraitance des prisonniers par les soldats américains a levé une polémique sur les moyens mis en place par les Etats pour parvenir à leur fin. La diplomatie force Obama à agir par un discours dans lequel il annonce que « l’Amérique ne torture pas » et qu’elle doit regagner une « réputation morale ». Cependant, Bigelow ironise en faisant de ce discours la simple toile de fond d’une réunion des tortionnaires des services secrets américains qui discutent sans même y porter attention. Il faut bien séparer la façade diplomatique et les attentes de la société. Nous sommes dans une société où seul le résultat compte quel que soit le moyen de l’obtenir.
L’autre sujet central de Zero Dark Thirty, c’est bien sûr la question de la torture. Jusqu’où un Etat, ou une institution, peut aller pour avoir ce qu’il veut ? Jusqu’où l’horreur des actions commises peut faire contrepoids à l’horreur des moyens mis en place pour réclamer justice ? Kathryn Bigelow ne ménage pas son spectateur en le faisant entrer dès la première scène dans les techniques de torture. Encore une fois, sa mise en scène ne cherche ni à minimiser ni amplifier l’horreur, elle relate simplement les faits. Surgit alors la face inhumaine de l’homme, celle qui montre qu’il est son propre adversaire et qu’il n’est civilisé que lorsqu’il le désire mais reste finalement un animal social. « Votre ami est un animal » confesse à bout Ammar (Reda Kateb) montrant bien le caractère double de l’homme. L’homme est un loup pour l’homme. Kathryn Bigelow rend encore plus acide ce constat par les singes présents sur la base militaire. Alors que la caméra fait un travelling au milieu de prisonniers cagoulés et attachés dehors dans des cages sous le soleil du désert afghan, elle s’arrête sur une cage avec des singes qui sont choyés et nourris. Le tortionnaire n’éprouvera des émotions qu’à la mort de ses singes et non de l’un des siens. La question politique et morale de la torture surgit sur la scène internationale par l’épisode d’Abu Ghraib mentionné dans le film. En effet, cette vidéo montrant la maltraitance des prisonniers par les soldats américains a levé une polémique sur les moyens mis en place par les Etats pour parvenir à leur fin. La diplomatie force Obama à agir par un discours dans lequel il annonce que « l’Amérique ne torture pas » et qu’elle doit regagner une « réputation morale ». Cependant, Bigelow ironise en faisant de ce discours la simple toile de fond d’une réunion des tortionnaires des services secrets américains qui discutent sans même y porter attention. Il faut bien séparer la façade diplomatique et les attentes de la société. Nous sommes dans une société où seul le résultat compte quel que soit le moyen de l’obtenir.
Note: ☆☆☆☆✖ – Excellent