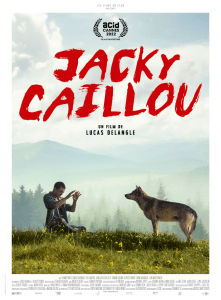73e Berlinale
Panorama
Sortie le 25 septembre 2024
Dans les rues endormies de Paris, Anthony Lapia saisit une société dominante à l’arrêt. Plan par plan, il troque l’architecture haussmannienne pour celle brute des lieux qui ne sont voués à n’être que de passage. Malgré tout, dans le vide d’un parking souterrain, une lumière rose devient le portail vers une contresociété peuplée d’une jeunesse plurielle. After choisit de se placer du côté de l’extase. Dans ce club techno clandestin, les corps se meuvent et se confondent dans une ivresse commune. Chacun·e cherche à transcender le poids du réel. Par la danse, le temps parvient à se suspendre avec un acharnement politique. Dans un espace annexe entre bar et fumoir, la parole ressurgit. Elle coordonne un troc, notamment de stupéfiants, où la contrepartie est la poursuite d’un bonheur collectif, même artificiel, qui doit continuer à tout prix. De ses échanges même succincts naissent des rencontres aléatoires entre des individus se percevant comme égalitaires.
Pour son premier long-métrage, Anthony Lapia s’empare d’un langage qui dépasse les simples mots. Sa caméra scrute les visages des danseur·euses et inventorie les entraves à cette utopie basée sur l’omission de la réalité extérieure à ce microcosme choisi et chéri. Sur le visage de Saïd (Majd Mastoura), des marques de fatigue trahissent son métier de chauffeur VTC qu’il vient juste de finir. Tandis que Félicie (Louise Chevillotte) évite les regards insistants d’une ex-partenaire éconduite. Une mélancolie teinte alors progressivement cette soirée dont le caractère d’exutoire ne peut malheureusement être qu’éphémère – à l’instar de ce fêtard suppliant ses ami·es de rester avec lui pour garder vivante cette fiction collective d’amnésie. Alors qu’elle dévide d’inviter Saïd pour un after chez elle, Félicie introduit un nouveau mode d’interaction sociale. Dans l’intimité de son appartement, l’avocate et le chauffeur réinstaurent, au gré des conversations, les codes sociaux. L’anonyme égalité offerte par la foule s’estompe progressivement.
Issu·es de deux milieux sociaux différents, Félicie et Saïd se heurtent à leurs visions divergentes du monde et de sa capacité de changement. Pourtant, iels sont habité·es par une même colère brûlante contre l’ordre établi. Face à la danse frénétique du club, iels s’engagent dans une autre chorégraphie plus codifiée : celle du désir. Anthony Lapia ne le réduit pas qu’à une simple satisfaction sexuelle. Il cherche à appréhender le mystère qui unit deux êtres, désenchantés. Ses deux protagonistes partagent le même besoin viscéral d’un regard et d’un corps offrant de la considération. Si la nuit est leur terrain d’expression, ils échappent à l’obscurité dans laquelle se cachent la solitude et le désespoir. Dans cette nuit où le jour ne pourrait jamais se lever, il reste une possibilité d’un futur autre – comme cette maison communautaire dans le sud de la France dont rêve Saïd. Tandis que le soleil ravive le réel, Anthony Lapia noie ses images de la capitale dans une surexposition qui en détruit les contours. Dans ce monde devenu illisible, il laisse éclore hors champ l’éventualité d’un embrassement, l’espoir que ce peuple de la nuit renversera à jamais celui du jour.
CONTRECHAMP
☆☆☆☆ – Excellent