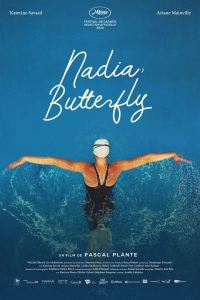76e Festival de Cannes
ACID
Sortie le 19 juillet 2023
Depuis le studio de la radio KMRD où elle tient une chronique sous le pseudonyme de DJ Barnacle, Caiti Lord contemple le paysage rocailleux du Nouveau-Mexique. Telle une vigie, elle s’aventure, autant pour ses auditeur·trice·s que pour elle-même, dans des monologues introspectifs face à cette immuable Amérique esseulée. Dans cette ancienne ville fantôme abandonnée en 1954 après la fermeture de l’exploitation minière, les destinées des habitant·e·s semblent également à l’arrêt, perdues entre des rêves déchus et des désirs hors d’atteinte. Dans les paroles de ses chansons qui ponctuent Caiti Blues, la jeune femme exprime ce poids pesant d’un présent intransigeant : « La réalité m’a rattrapée / J’suis trop engourdie pour la sentir ». Cette implacable réalité s’obscurcit par le remboursement impossible d’une dette étudiante de 36 000 dollars, croissant insidieusement chaque année à cause des intérêts. Pour joindre les deux bouts, la jeune femme de 29 ans travaille également à la Mine Shaft Tavern pour un salaire de 4 dollars de l’heure et de précieux pourboires taxés. Comme ses jeunes collègues qui songent à une vie meilleure à Los Angeles, elle partage une ambition qui dépasse les limites de cette ville oubliée.
« Je ne peux ni rester, ni partir / Il faut que je respire » confesse Caiti en musique. C’est cette respiration salvatrice que Justine Harbonnier parvient à saisir et qui habite tous les plans de Caiti Blues. Les images se teintent de la résilience solaire de cette artiste anonyme. Lorsque de petites victoires (une audition réussie, un rendez-vous) surgissent, la cinéaste quitte son rôle d’observation pour laisser exploser une complicité construite sur une dizaine d’années depuis le tournage dans le sud de la Floride de son court-métrage documentaire Il y a un ciel magnifique et tu filmes Angèle Bertrand [2014]. Par le biais de souvenirs familiaux gravés sur la bande magnétique de VHS, la cinéaste retrace le portrait d’une enfant hors norme cherchant à trouver sa voix/voie. En prolongeant le format 4:3 dans le présent, Caiti Blues manifeste à la fois la continuité de cette quête intérieure et la perte d’horizon qu’implique le passage à l’âge adulte. À la manière de cette guérisseuse qui ouvre l’œuvre, le chant – sa véritable drogue – lui permet d’extirper la noirceur de la vie. Le « blues », dans son double sens, est à la fois le mal et la solution qui lui permet de « se réveiller ».
Tel ce cactus orné de guirlande qui illumine les nuits durant l’hiver, l’aura solaire de Caiti est le point de ralliement de la communauté marginale de Madrid. Caiti Blues est marqué en filigranes par la présence fantomatique de Donald Trump. La jeune artiste observe une société où « tout se réduit en cendres sous [ses] yeux ». Préférant ne plus regarder les informations pour essayer de trouver le sommeil, elle fait partie d’une génération ayant grandi post-11 septembre, donnée en sacrifice à la peur et à la bigoterie. Autour de Caiti, une communauté queer s’organise pour ne pas plonger dans l’obscurité. Lorsqu’elle reprend « Sweet Transvestite » de The Horror Picture Show [Jim Sharman, 1973], comédie musicale emblématique, lors d’un drag show local, Caiti témoigne de la vivacité d’une contreculture américaine qui ne peut être muselée. La caméra de Justine Charbonnier affectionne cette Hollyweird comme écrit dans le décor du spectacle, cherchant dans les fêlures d’une Amérique gangrénée le réenchantement d’une nation toute entière.
CONTRECHAMP
☆☆☆– Bien