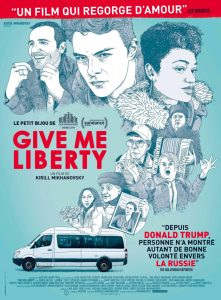36e Festival de Sundance
Sélection Officielle
Sortie nationale le 18 août 2021
Dans la périphérie de Mexico, le paysage urbain s’uniformise en de modestes maisons mitoyennes blanches. L’une d’elles est habitée par une mère célibataire, Valeria (Sophie Alexander-Katz), et son fils adolescent, Rodrigo (Adrián Rossi). À contre-pied de cette uniformisation, iels se sont construit.e.s un univers coloré et composite dans lequel iels évoluent en harmonie. Lors de la première séquence de Summer White, l’adolescent de 13 ans traverse le couloir, muni d’un briquet éclairant les ténèbres de la nuit, pour rejoindre la quiétude du lit maternel. Le lendemain matin, le duo exécute une chorégraphie ordinaire dans une salle de bain qu’iel partage au quotidien. Rodrigo Ruiz Patterson filme, avec délicatesse, une intimité fluide et libératrice édifiée (et renforcée) par l’absence d’une figure paternelle. Le père de Rodrigo n’existe qu’en hors champ par le biais d’un appel téléphonique que le fils décline, entraînant le mensonge de sa mère (« il dort déjà »), ou encore par les vaines menaces maternelles de la fin de cette oasis (« tu vas aller vivre chez ton père »).
Or, ce cocon d’affection est bouleversé par l’irruption de Fernando (Fabián Corres) présenté d’abord comme un nouvel « ami » de Valeria. Alors que la relation se concrétise, l’adolescent consume sa colère dans un cimetière automobile en explosant pare-brise et carrosserie. Il fait de cet espace délaissé le réceptacle de sa propre frustration face au délitement de son foyer. Lorsque Fernando emménage, la dissonance s’intensifie. Summer White symbolise cette peinture d’un blanc voulu chaleureux, décidée par le jeune couple, qui annihile l’éden préalablement créé par une mère et son fils fusionnels. Rodrigo Ruiz Patterson érige conjointement deux figures masculines cherchant à s’approprier un espace : d’une part Fernando qui tente de trouver sa place ; d’autre part Rodrigo qui se bâtit, dans la carcasse d’un camping-car, un nouveau chez lui. Pour renforcer la contradiction de ces envies pourtant similaires, le cinéaste donne les mêmes outils aux deux hommes – les fournitures achetées pour Fernando, les restes volés pour Rodrigo.
Avant tout, Summer White est un coming-of-age autour de ce jeune homme mutique. Rodrigo est encore un enfant jouant à être un adulte à l’instar de cette scène où, au volant d’un pick-up abandonné, il interprète un conducteur – à la masculinité (toxique) stéréotypée – faisant la rencontre érotique d’une auto-stoppeuse. De cette saynète fantasmée, l’adolescent ne gardera que les bruits de moteur produits par sa bouche qui serviront de référence ultérieurement afin de trouver le point de patinage lors des leçons de conduite de Fernando. Ce point de patinage que l’adolescent ne parviendra jamais à trouver est symptomatique de la brusquerie qu’il témoigne envers cette transition familiale. Les expressions affectives se répètent et s’altèrent à l’image de cette séquence de slow mère-fils devant un sapin de noël artificiel, où la mère insiste pour le regard soit soutenu, qui se reproduit avec Fernando à la place de Rodrigo – ne laissant à ce dernier que les miettes d’un regard succinct à travers la fenêtre du salon. Summer White figure des amours contrariés entre celui infini d’une mère aspirant à rester une femme et celui dissimulé d’un fils en quête d’identité.
La singularité du premier long-métrage de Rodrigo Ruiz Patterson est, cas rare dans les coming-of-age, de ne pas proposer d’autre altérité que celle de l’adolescent. Éliminant toute dramatisation superficielle dans la relation entre Rodrigo et l’amant de sa mère, le cinéaste mexicain prêche une douceur, embellie par la photographie de María Sarasvati Herrera et uniquement noircie par le mal enflammant les pensées de cet enfant pyromane. Summer White trouve dans le dépouillement de son scénario et de ses effets le moyen d’évoquer des moments d’intimité fugaces magnifiés par la richesse et la profondeur de jeu d’Adrián Rossi, de Sophie Alexander-Katz et de Fabián Corres.
Le Cinéma du Spectateur
☆☆☆ – Bien