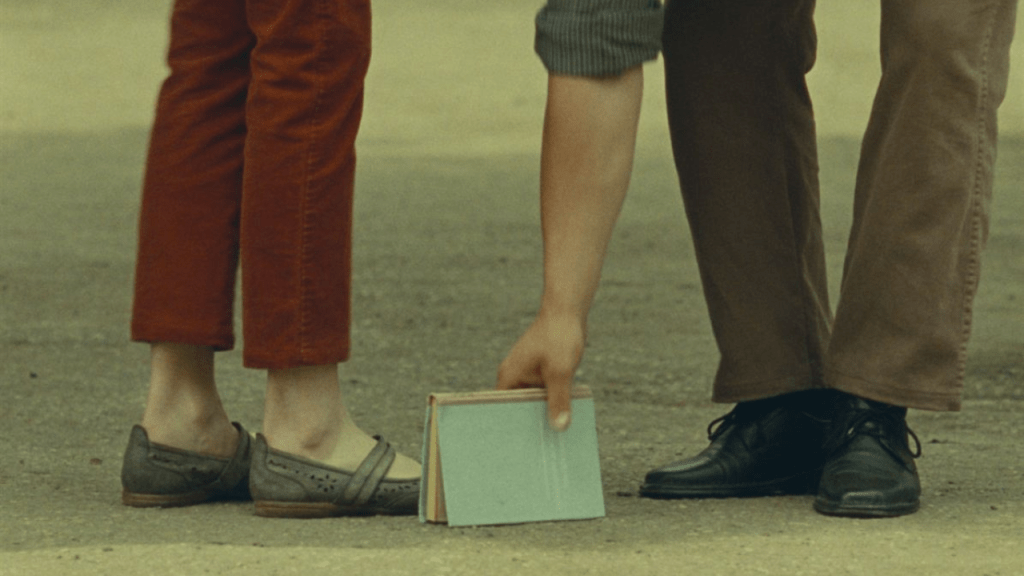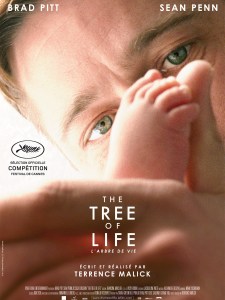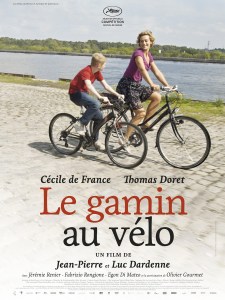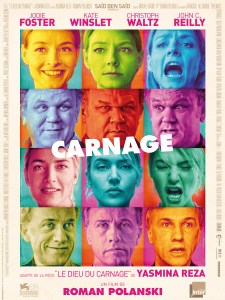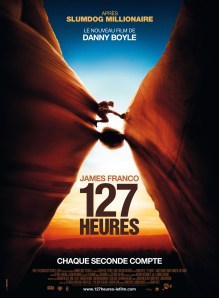Sortie d’un songe sans rêve, Sangok (Hye-Young Lee) inaugure Juste sous vos yeux en prophétisant que « toutes les choses devant [ses] yeux sont une bénédiction ». À l’instar de Hong Sang-Soo, l’actrice réaffirme l’importance du regard, pensé comme une manière consciente et active d’appréhension de son environnement. Performatif autant pour elle que pour le·a spectateur·rice, ce mantra devient le symbole d’une année riche où les cinéastes accordent à la trivialité du quotidien une bénédiction le métamorphosant en trésors. Comme maudit, ce regard sacré sur le présent naît chez Sangok à condition que la possibilité d’un futur s’estompe. Cette annihilation des autres temporalités, passé et futur, permet une reconfiguration immaculée de l’identité. Dans la ville géorgienne de Koutaïssi, un mauvais œil espiègle altère l’identité de deux amoureux·ses voué·e·s à s’aimer. Chez Aleksandre Noberidze (Sous le ciel de Koutaïssi), le présent, libéré de toutes contraintes identitaires, devient un territoire d’exploration dans la langueur de l’été. Pour Lisa (Ani Karseladze/Oliko Barbakadze) et Giorgi (Giorgi Bochorishvili/Giorgi Ambroladze), l’apprentissage d’une nouvelle manière de regarder permet à la fois une redécouverte de soi et de l’autre.
Dans cette même recherche d’un soi cinématographique, l’œuvre collective Qui à part nous soulève un enjeu cinématographique et politique du cinéma, principalement documentaire, en cherchant à créer un lien direct entre le sujet et la narration. Jonás Trueba questionne les jeunes sur la manière dont iels se sentent représenté·e·s au cinéma. Alors qu’iels affirment que leurs vies sont dramatisées à outrance – notamment par le prisme de l’addiction à la drogue, l’une des adolescent·e·s avoue qu’elle souhaiterait qu’iels soient représenté·e·s « comme des personnes ». La simplicité de la réponse témoigne avec force de la distance qui s’est instaurée entre la jeunesse et celleux qui les regardent. Dans Toute une nuit sans savoir, Payal Kapadia documente avec cette même question, la place d’une jeunesse en révolte dans une société politiquement figée (notamment par les castes), les manifestations étudiantes en Inde commencées en 2017. Avec une mélancolie teintée des fantômes des vies détruites, la cinéaste illustre l’immuabilité d’un présent asphyxié par le poids du conservatisme de la société indienne. Dans un geste cinématographique exquisément anticonformiste, João Pedro Rodrigues transfigure dans Feu follet le poids de l’histoire portugaise à l’aune d’une fantasque réécriture queer où le territoire devient le corps de pompiers pansexuels, leur pénis symbolisant les différents domaines forestiers du pays. En déplaçant son regard en dehors des codes préétablis, le cinéaste portugais renoue avec l’inattendu, sublimant les interstices d’une histoire officielle dans lesquels demeurent la richesse des modes de vie alternatifs.
À travers le corps touché par la grâce d’Elsa Wolliaston, Damien Manivel ressuscite, en prônant une radicalité cinématographique transcendantale, une spiritualité préchrétienne dépouillée de tout diktat ecclésiastique. Marie-Madeleine forge son propre culte christique trouvant dans son rapport intime avec Jésus une passerelle émotionnelle entre les temporalités et les réalités. Dans un même geste libérateur d’une domination institutionnelle et instituée que chez Rodrigues, Magdala replace l’individu au centre de la notion de spiritualité offrant à sa protagoniste, via la puissance figurative du medium cinématographique, le don de sculpter l’invisible. Chez Albert Serra, le politique est également une mise en scène qui s’exprime par le biais du corps. À l’inverse de Damien Manivel, Pacification – Tourment sur les îles prône une débauche verbale qui se vautre dans une vacuité formalisée. L’étirement des séquences transforme les échanges entre De Roller (Benoît Magimel) et les concitoyen·ne·s en des monologues absurdes louant le néant des manœuvres d’un pouvoir toujours colonialiste. L’œuvre se fait le miroir critique, transcendé par les néons du « Paradise Night », d’un exotisme difforme où le·a Tahitien·ne n’est vu·e – par les personnages blancs – qu’à travers leurs propres fantasmes.
Dans un même mouvement de libération d’un regard préconçu – celui d’une société intellectuelle française scrutant le visage d’un paysan séminariste de 17 ans ayant décapité un enfant de 12 ans, Bruno Reidal libère son protagoniste éponyme, par le biais de l’écriture d’abord factuelle (son milieu social, sa famille) puis poétique, non dans le sens d’une franchise chrétienne expiatoire, mais dans la démonstration sincère, car ressentie, d’une perversité assumée. Bruno (Dimitri Doré) s’extirpe de son statut de cobaye psychosociologique qui le définit dans un premier temps : « 1m62, 50kg, apparence délicate, carrure faible… ». Littéralement mis à nu, il se meut en bétail sacrificiel, déjà condamné, semblable au cochon égorgé chaque année chez les Reidal. C’est d’ailleurs par le prisme du monde animal que le cinéma aura atteint cette année ses sommets d’abord formellement par la réalisation extraordinaire qui accompagne les pérégrinations de l’âne martyr de Jerzy Skolimowski (EO), dressant à travers ses yeux le portrait d’une humanité prédatrice et avide. Cependant, c’est par le travail documentaire d’Andréa Arnold autour de la vie d’une vache dans Cow que le cinéma se libère avec une force inouïe de tous les biais de son regard. La cinéaste anglaise accompagne le regard de sa protagoniste laitière, acceptant pleinement sa position de reflet d’une intériorité psychologique invisibilisée.
Le classement qui suit prend en compte les œuvres sorties en 2022 à la fois en salles et sur les plateformes de VOD ou de streaming. De plus, il considère également les œuvres vues en festival dont la sortie en France, faute de distributeurs intéressés, reste encore incertaine – de la sorte Days de Tsai Ming-Liang a été comptabilisé pour l’année 2020 et Vitalina Varela de Pedro Costa pour l’année 2019.
10. Cow,
Andrea Arnold
(Royaume-Uni)
9. Feu Follet,
João Pedro Rodrigues
(Portugal)
8. Qui à part nous,
Jonás Trueba
(Espagne)
7. Juste sous vos yeux,
Hong Sang-Soo
(Corée du Sud)
6. Sous le ciel de Koutaïssi,
Aleksandre Koberidze
(Géorgie)
5. EO,
Jerzy Skolimowski
(Pologne)
4. Magdala,
Damien Manivel
(France)
3. Toute une nuit sans savoir,
Payal Kapadia
(Inde)
2. Bruno Reidal – Confession d’un meurtrier,
Vincent Le Port
(France)
1. Pacifiction – Tourment sur les îles,
Albert Serra
(Espagne, France)