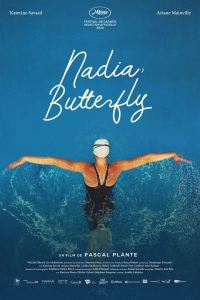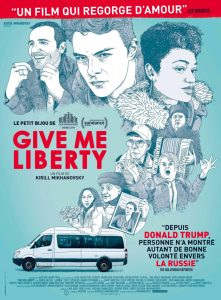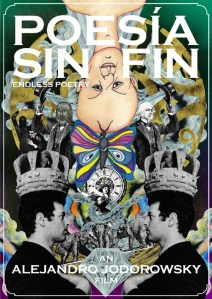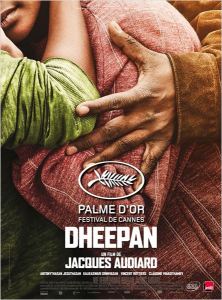74e Festival de Cannes
Sélection officielle
Sortie le 1er décembre 2021
Dans un bus surchargé, une contrôleuse de tickets – déguisée comme la « Reine des Neiges » – se faufile de sa gouaille entre des passager.e.s échauffé.e.s. Dans ce microcosme étouffant, Petrov (Semyon Serzin) crache sans relâche ses microbes. Alors qu’un vieil homme tient des propos déplacés à une petite fille lui ayant laissé sa place, la fièvre monte autant dans le bus que dans la tête de Petrov. Cette fièvre, perçue comme un bouillonnement frénétique, est l’essence d’une société russe complètement désinhibée, ulcérée par le racisme, le sexisme et l’homophobie. Dans la Russie verdâtre de Kirill Serebrennikov, la violence verbale et/ou physique se révèle aussi constituante que cathartique. Alors que résonne la phrase « il faudrait fusiller les dirigeants », La Fièvre de Petrov enfante une langue qui, comme outil performatif, accomplit sa propre révolution. De là, des hommes cagoulés tels des catcheurs exhortent Petrov à participer à un peloton d’exécution en pleine rue ciblant de puissant.e.s politicien.ne.s.
Cette théâtralisation du réel, flirtant avec le burlesque, se justifierait par la maladie dont souffre le protagoniste. Cependant, la même fureur se retrouve chez Petrova (Chulpan Khamatova), sa femme bibliothécaire. Face à un club de poésie dégénérant en règlement de comptes, elle transforme sa rage bouillonnante en une chorégraphie fatale d’arts martiaux qu’elle conclue, d’un ironique changement de ton, par « j’ai juste vu des films, ce n’était pas prévu ». Conduisant à des frénésies mortifères imaginées ou réelles, sa souffrance naît d’une vie désincarnée. Inspirée par le cinéma, cette violence est exaltée par la télévision où le journal télévisé annonce la mort de l’homme de la bibliothèque lors d’une attaque sauvage en pleine journée dans la rue. Avec de l’alcool pour combustible, l’art devient alors chez Kirill Serebrennikov cet espace trouble de liberté où la morne stabilité du réel, entendue comme une domestication du citoyen à sa propre domination, se transgresse. Une fois que le contrat social est dissous, les personnages de La Fièvre de Petrov revendiquent, à l’instar de Petrova, l’exercice (ir)raisonné d’une violence symbolique. Dans le Iekaterinbourg de Serebrennikov, l’autodétermination d’un mort lui permet même de décider de mourir à un autre moment.
La caméra du cinéaste russe accompagne cette fureur libératrice dans une danse affranchie de toute spatialité, déconstruite par une remarquable direction artistique et une orfèvrerie de montage, et de toute temporalité, la vie de Petrov se déroulant par écho émotionnel. Œuvre protéiforme allant de l’animation à la science-fiction, La Fièvre de Petrov est perméable aux émotions de ses protagonistes qui dynamitent son cadre. Ici, la vie virevolte entre poésie et vulgarité cherchant dans l’excès et dans le brouhaha une narration primaire, exempte d’une canonique linéarité. Fantomatiques, les personnages construisent dans le chaos ambiant leur propre destinée comme cet écrivain raté orchestrant son propre suicide en quête d’une gloire éternelle. Au-dessus d’une morale commune, ils sont des figures irréelles, s’apparentant à des archétypes triviaux, dont le drame n’est concevable qu’en un spectateur consentant à se perdre dans la boue noble de leurs dépravations. Néanmoins, cette violence transcendantale s’effrite dans une ultime sinuosité narrative, centrée sur la vie de la jeune femme interprétant la « Reine des Neiges » alors que Petrov – encore enfant – assiste à une représentation complètement grippé, dont le classicisme tranche avec le souffle de ce Dostoïevski sous antidouleurs périmés depuis 1977.
Le Cinéma du Spectateur
☆☆☆ – Bien